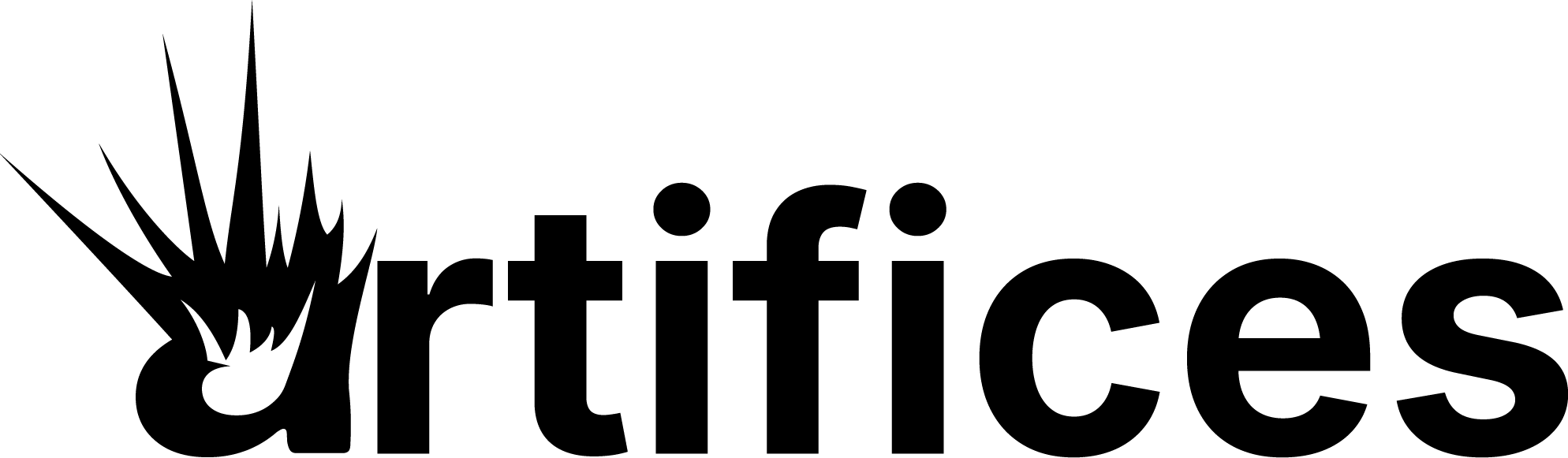CLASSE MOYENNE ET THÉORIE DES CLASSES – QUESTIONNEMENTS SUR LE 10 SEPTEMBRE ET L’INTERCLASSISME
Le 14 octobre dernier, nous avons organisé une discussion autour de la question de la définition des classes sociales et tout particulièrement de l’énigmatique classe moyenne, à l’heure où la participation de cette population aux contours flous, coincée entre le marteau et l’enclume du prolétariat et du capital, est régulièrement mise en avant pour discréditer un mouvement social ou, au contraire, dissoudre toute perspective de classe dans le grand bain enthousiaste du « peuple révolté ». Dans la foulée du 10 septembre, nous nous étions fixé l’objectif de questionner les réflexes, tant mouvementistes qu’attentistes, vis-à-vis des luttes de classes considérées dans la réalité de leurs manifestations. Ce texte est donc une reprise de la présentation que nous avons faite, enrichie et adaptée grâce aux discussions qui en ont découlé. Ce travail – toujours en cours – constitue une brève introduction aux riches débats sur cette question animant la théorie révolutionnaire, mais aussi une invitation à penser les mouvements contemporains à l’aune de l’analyse de classe, seule à même de comprendre les formes sinueuses et insolentes que revêtent les luttes de notre temps.
Introduction
Les derniers épisodes de lutte des classes en contexte français – des Gilets Jaunes au soufflé du 10 septembre – ont connu leur lot de débats aussi denses qu’agités sur leur composition sociale. Si de nombreuses personnes préfèrent depuis quelques décennies parler de peuple, de citoyen·nes, de jeunesse ou pire encore, il nous semble pour notre part toujours pertinent de développer une analyse de classe. Nous estimons que la société actuelle ne se comprend que si l’on reconnaît qu’elle est structurée par un mode de production spécifique : le capitalisme. Dans ce dernier, des classes agissent selon des intérêts contradictoires en fonction de la place qu’elles occupent au sein des rapports de production, c’est ce qu’on appelle la lutte des classes. Cette dernière a cours au quotidien, partout où règne le salariat, même lors des périodes de relative accalmie. De plus, la plupart des luttes restent liées à l’existence des classes sociales – ce que la sociologie nomme maladroitement les inégalités –, puisque la contradiction entre la masse des travailleur·ses et le profit créé y reste centrale, et, partout dans le monde, les luttes les plus importantes du XXIe siècle ont été le théâtre d’une participation majeure du prolétariat. Ce dernier a en effet été incontournable des printemps arabes aux Gilets Jaunes, des émeutes Black Lives Matter aux insurrections actuelles en Asie du Sud-Est. Toutefois, il n’a pas fait cavalier seul, ce qui pose aussitôt problème dans la question de la définition de ce prolétariat censé accomplir la révolution et, en filigrane, de celle de la classe moyenne. C’est à cette question que nous proposons de nous atteler.
Pendant longtemps, les définitions des classes sociales n’ont posé que peu de problèmes, l’existence même du vieux mouvement ouvrier résolvant de fait toutes les questions : la classe ouvrière, dotée d’une existence sociologique et politique tangible1 permettant de la reconnaître au premier coup d’œil est le prolétariat, et réciproquement. Tout se brouille alors quand le vieux mouvement ouvrier s’effondre. Au cours des années 1970, de nombreux phénomènes coïncident (intensifications des luttes ouvrières à travers l’Europe, baisse de la valorisation du capital, augmentation du coût des matières premières et de l’énergie2), entraînant une restructuration du mode de production. On ne sort pas du capitalisme, la société reste fondée sur la contradiction entre le travail et le capital, mais le rapport qui unit ces deux termes se modifie.
Il faut s’arrêter un moment pour clarifier ce que l’on entend précisément par restructuration. Ce terme n’induit pas de transformation fondamentale du mode de production, le rapport principal qui fonde la société capitaliste demeurant la contradiction entre le travail et le capital, entre les travailleur·ses exploité·es et les capitalistes qui extirpent de la plus-value de l’exploitation de leur force de travail. Mais la formation historico-sociale n’est plus la même que lors des décennies précédentes, et a fortiori du siècle dernier. Le capitalisme s’adapte au ralentissement de la productivité, il réorganise les bases sur lesquelles il fonctionnait pour continuer à extraire de la plus-value, pour continuer de se valoriser en permanence. Pour cela, il faut tourner la page de l’éphémère compromis fordiste qui n’était qu’un simple moment du capital mais fonctionnait comme un cercle vertueux depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Le développement technologique et la machinisation font que le capital produisait des marchandises contenant de plus en plus de valeur ajoutée, ce qui s’accordait avec le fait que la production industrielle nationale et le marché intérieur – c’est-à-dire la consommation des prolétaires français·es – marchaient de concert. Les usines produisaient des marchandises qui étaient ensuite consommées par les ouvrier·es qu’elles employaient. Ces dernier·es reçoivent progressivement davantage de plus-value, parce que les marchandises produites ont une valeur ajoutée plus grande. Le compromis fordiste assurait aux classes populaires non seulement une stabilité, mais aussi une augmentation de leur niveau de vie, et donc de leur consommation. Autrement dit, le deal était : “on augmente les cadences et, en contrepartie, on augmente les salaires”.
Mais l’éclatement des marchés intérieurs et leur ouverture accélérée à la concurrence ont fragilisé cet équilibre savamment construit : par la mondialisation des capitaux, on assiste à une baisse directe de la valorisation du capital au sein de chaque pays. Pour faire simple et schématique : on peut extraire moins de plus-value des travailleur·ses occidentaux·ales qu’auparavant, d’autant que nombreux sont les pays qui rattrapent leur retard industriel à marche forcée, proposant donc de fait une main d’œuvre forcément plus attrayante en termes de profit immédiat. Ce double mouvement va, conjointement avec la pression des assauts prolétariens dans les vieux centres capitalistes, inciter le capital à continuer de se mondialiser, et à délocaliser ses moyens de production.
Par ailleurs, si l’on parle également d’une restructuration du capitalisme lors des années 1970, c’est aussi en grande partie dû au cours de la lutte des classes. A partir de la charnière de Mai 68, le prolétariat se révolte en de nombreux endroits, revendiquant une meilleure redistribution générale du profit, un accès généralisé à l’éducation supérieure et à la spécialisation en-dehors du monde ouvrier pour leurs enfants, etc. Constatant que la reproduction d’une force de travail ouvrière stable et permanente dans les vieux centres occidentaux ne peut plus être tenue socialement et politiquement, il n’y a guère d’autre choix au capital que d’aller la chercher ailleurs.
Les conséquences concrètes de cette évolution sont catastrophiques pour le prolétariat, ses luttes et ses porte-paroles politiques. Les délocalisations anéantissent le paysage industriel ouest-européen, ce qui laisse les syndicats impuissants. Le⋅a travailleur⋅se précaire remplace l’ouvrier spécialisé (OS) comme figure du/de la prolétaire, les partis de masse s’effondrent, le prolétariat est segmenté, atomisé, plus aucune base n’existe à partir de laquelle construire l’unité de ce dernier. En définitive, la classe de la révolution n’apparaît plus distinctement au travers de luttes massives et organisées.
À partir de cette période, on peut résumer les trajectoires des théories révolutionnaires en trois catégories.
La première regroupe celleux qui sont dans le déni, qui ne reconnaissent pas le changement qui a eu lieu au sein du mode de production et tentent en vain de recréer la glorieuse classe ouvrière d’antan en l’absence des conditions qui permettaient son existence.
Ensuite, on trouve toutes les théories abandonnant purement et simplement la catégorie de classe, lui substituant le peuple, les citoyen·nes, la jeunesse, la bande de potes du Comité Invisible ou encore les 99% (opposés aux 1% d’oligarques) dont on nous bassinait encore les oreilles il y a quelques années. Nous ne les réfutons pas par dogmatisme, mais parce qu’elles s’avèrent incapables de nous expliquer pourquoi tel ou tel segment de la population se mobilise, quand et comment, et ce à quoi ses luttes peuvent aboutir. Elles passent alors par des analyses posées en termes de désir et de volonté d’une somme d’individualités – abandonnant donc complètement une analyse d’ensemble pour tomber dans des travers au mieux psychologisants, au pire vitalistes – ou bien fantasment inlassablement un ensemble, la classe ouvrière, comme seule identité possible du prolétariat. Dans tous les cas, ces approches se cassent les dents sur le mouvement réel de la lutte des classes. La seule explication qu’on nous donne c’est que “les gens” (ou “la base” syndicale) seraient aliéné·es et/ou manipulé·es, mais au bout d’un moment, si on sait se montrer persuasif·ves, iels se rendront tout de même bien compte que le monde tournerait mieux si on écoutait les révolutionnaires.
C’est donc dans une troisième et dernière catégorie que l’on va retrouver les thèses qui nous intéressent aujourd’hui : celles qui tentent de repenser les classes sociales à partir du contexte actuel.

Les récents mouvements sociaux ont donné lieu à une multitude d’analyses de qualité inégale sur le rôle qu’y avait joué la classe moyenne (ou l’un de ses alias sans qu’elle soit nommée comme telle), que ce soit pour s’en réjouir ou le déplorer. Ces débats ont lieu par blogs interposés, au sein de séminaires universitaires ou à chaque discussion entre militant·es où l’on se traite copieusement de petit·es bourgeois·e ou de prof, quand l’expression “classes moyennes” n’est pas simplement utilisée comme synonyme de “bobos”. Si de nombreux usages du concept semblent pour le moins limités, cette récurrence langagière montre toute l’actualité et l’importance de cette question pour comprendre ce que diable se passe dans cette satanée lutte des classes.
Interclassisme et mouvements sociaux
Si l’on parle autant des classes moyennes dans nos milieux, c’est en raison de deux phénomènes concomitants : la décrépitude du vieux mouvement ouvrier, et l’interclassisme comme forme actuelle d’une partie de la lutte des classes. Comme évoqué plus haut, les années 1970 marquent le début du déclin du mouvement ouvrier organisé comme déterminant la forme des luttes de classe, principalement sur les lieux de travail, ce qui a mené à l’émergence de la forme interclassiste des “mouvements sociaux” auxquels nous sommes habitué·es. De la lutte contre le plan Juppé de 1995 au 10 septembre dernier en passant par le mouvement contre le CPE de 2006, des réformes des retraites de 2010 ou encore de 2023, les mobilisations se sont centrées autour de revendications politiques, c’est-à-dire vis-à-vis de l’État (abrogation d’une loi ; opposition à l’utilisation du 49.3 ; parfois réclamer une mesure, la chute d’un gouvernement, voire d’un président).
Ce déplacement de revendications liées à la production et au travail à celles actuelles concernant l’État – donc la distribution a posteriori de la plus-value sociale – est un produit direct des transformations du mode de production capitaliste (MPC).
Avant que n’advienne cette fameuse restructuration, le capitalisme industriel produisait une classe ouvrière à l’existence sociologique tangible (grande usine, culture et villes ouvrières, etc.). À partir de cette dernière, un sujet politique “naturel” pouvait émerger : l’identité ouvrière, qui fondait et cadrait les luttes de classes. Désormais, les revendications sur le pouvoir d’achat désignent l’État, qui était le régulateur de la politique de revenus, comme seul responsable. Il est alors à la fois la cible des critiques et le principal interlocuteur, par l’intermédiaire duquel se joue la lutte des classes. On critique la collusion entre le gouvernement et le pouvoir économique qui détournerait l’État de son rôle supposé : servir l’intérêt général et redistribuer équitablement la “richesse sociale”. C’est là que s’enracinent toutes les revendications de “justice” sociale, fiscale, écologique, etc. : il faut remettre les pendules à l’heure, du temps où tout fonctionnait (à peu près) correctement ! Les classes réellement en lutte le font sous la forme d’une société civile composée “d’honnêtes citoyen·nes” se révoltant contre un “État néolibéral” et des “élites hors-sol”. Si tout cela est bel et bien affaire d’idéologie, il faut garder en tête que cette dernière est produite par la configuration présente de la lutte des classes. Les organes syndicaux ont pris acte de la restructuration et de leur obsolescence à terme. Ils ont donc progressivement cessé d’être l’émanation institutionnelle du mouvement ouvrier pour endosser les intérêts d’un “monde du travail” aux contours flous. Cette redéfinition d’un sujet politique caractérise le cadre historique à partir duquel peuvent encore (rarement) se négocier les conditions de l’exploitation avec la classe capitaliste et ses relais. Seulement, l’unité ne va plus de soi et on doit alors la construire par la “convergence des luttes” – notamment au travers d’interminables assemblées générales où tout·e un·e chacun·e est invité·e à faire fondre son morceau d’indignation dans la grande marmite de la grogne populaire.
L’une des grandes caractéristiques du militantisme actuel est en effet l’accent porté sur l’auto-organisation, principe magique auquel donnerait vie la multiplication de canaux Telegram et d’assemblées de quartiers attentives aux “réalités locales”3 – qu’il importe bien entendu de protéger de la “récupération” partisane. Pourtant, si l’auto-organisation contre les partis suffisait à faire advenir la révolution prolétarienne, Nuit Debout aurait sonné le glas de plus de deux siècles de capitalisme4. Le spectacle auquel nous assistons dans les AG – où les témoignages de tel ou telle acteur·ices sectoriels (les grévistes de telle entreprise, les étudiant·es de telle fac) se succèdent sans que l’on voit vraiment comment tout ce beau monde pourrait marcher ensemble de façon coordonnée – montre que cette unité proposée par le mouvement social est une illusion : elle n’a aucune essence en elle-même, mais est seulement forgée par la somme de ces composants. Toutes les divisions qui fragmentent le “peuple” (et même les différentes fractions de classe) minent cette artificielle addition de colères jusqu’à implosion.
Même au sein de la frange considérée comme la plus “radicale” du mouvement social, le cortège de tête, ce sont les classes moyennes conscientes de leur avenir qui ont mené la lutte, y compris par un recours à la violence, du moins symbolique5. Si les grèves sauvages pouvaient encore faire l’objet de fantasmes du temps de l’autonomie italienne, beaucoup de militant·es se rendent bien compte que quelque chose coince aujourd’hui. La solution est alors toute trouvée, et auréolée d’une analyse vaguement marxiste : puisque le capitalisme est partout, que les centres industriels sont maintenant hors de nos frontières et le prolétariat atomisé, le combat se trouve alors non pas dans la sphère de production mais dans celle de la circulation. C’est sur les blocages et les piquets volants que s’épanouit le “tou·tes ensemble”, sans que le critère du salariat ne se dresse comme une barrière à l’action.

Au bout du compte, on ne lutte pas au nom du prolétariat mais comme simple citoyen·ne. Tout cela n’est pas sans conséquence : la classe moyenne s’aménage une place de choix dans le leadership des mouvements sociaux et impose ses mots d’ordre à l’ensemble des fractions de classe mobilisées. Il s’agit de corriger les dysfonctionnements dont souffre la démocratie républicaine (éventuellement en adoptant une nouvelle constitution flambant neuve), de redonner vie au “service public”, bref, de remettre l’Etat au centre de la société.
On voit donc que le fond de l’air est interclassiste. À gauche, le capitalisme est pensé comme un rapport de pouvoir avant tout, l’économie étant vue comme une sphère séparée et objective pouvant être remodelée autour de l’avatar du moment : avant les ouvrier·es, maintenant les “gouverné·es” ou une variation quelconque, du moment qu’y est incluse la classe moyenne. On peut se lamenter de cet état de fait – certain·es s’en sont fait une spécialité –, mais il nous semble pour notre part plus fécond de revenir à notre point de départ et de prendre au sérieux les classes en scène, et ce qui les met en mouvement.
La classe moyenne à la dérive
La définition de la classe moyenne a fait couler beaucoup d’encre, surtout à partir des années 1970, lorsque sa présence dans la société aussi bien que dans les luttes ne pût plus être esquivée par aucun·e commentateur·ice. On ne va pas dresser ici un panorama exhaustif de ses différentes tentatives de définitions mais nous concentrer sur celles que nous avons jugées les plus intéressantes. Précisons d’emblée que la petite-bourgeoisie au sens courant du terme – c’est-à-dire les indépendant·es, l’artisanat, etc. – ne concerne pas notre propos. Elle relève en effet de formes de production anciennes, aujourd’hui résiduelles, qui peinent à se maintenir face à la concentration du capital. Condamnée à une survie précaire aux marges du marché, cette fraction sociale tend soit à disparaître sous la pression de la concurrence, soit à être absorbée par le capital.
En 1974, Baudelot, Establet et Malemort6 (que nous prenons la liberté d’abréger BEM) trois sociologues du PCF, tentent de définir une “nouvelle petite-bourgeoisie”, moyen détourné pour le Parti de faire quelque chose des larges franges de la population qu’on arrive plus à intégrer au schéma bourgeoisie/prolétariat classique du marxisme orthodoxe. Pour cela, ils calculent le salaire nécessaire pour reproduire la force de travail (assez d’argent pour s’acheter de quoi manger, se nourrir et se divertir au minimum afin de pouvoir retourner au travail le lendemain), et identifient les professions qui en reçoivent davantage. Ils les regroupent en trois catégories, affublées d’un comportement politique supposé :
1. les indépendants et artisans : réaction/poujadisme
2. la fonction publique d’Etat : progressisme/alliance avec le prolétariat
3. les cadres du privé : centrisme/alliance avec le capital.
À partir de cette piste, Astarian et Ferro vont proposer en 20197 une définition de la classe moyenne salariée comme classe percevant un sursalaire. Ils abandonnent la classification initiale de BEM, remettant en cause la pertinence de leur séparation public-privé, et en excluent les indépendant·es et artisan·es. Pour les deux auteurs, certain·es salarié·es reçoivent, en complément du salaire permettant de reproduire leur force de travail, une portion additionnelle de la plus-value sociale totale en échange des fonctions d’encadrement qu’iels réalisent pour le capital. L’accès à ce sursalaire se fait par les diplômes scolaires, d’où l’importance pour cette classe moyenne salariée des luttes autour de l’accès à l’université. La classe moyenne salariée (CMS) réunit ainsi les fonctions d’encadrement classiques de la sphère productive (les contremaîtres), et celles qui ne cessent de croître et de s’institutionnaliser : celles de la sphère reproductive. On peut citer les profs, les manager·euses, les ingénieur·es, etc. À la suite de leur définition, les auteurs concluent que la classe moyenne a intérêt au maintien du capitalisme dont elle tire sa domination sur le prolétariat. S’il lui arrive de s’opposer au capital pour négocier le montant de son sursalaire, la CMS demeure en dernière instance contre-révolutionnaire. Les deux auteurs montrent alors, dans une série d’exemples à travers le monde et la décennie passée, comment la classe moyenne tend à se retourner, au cours des insurrections, contre le prolétariat, causant – ou du moins participant – à la défaite du mouvement. Si cette définition met judicieusement en lumière qu’une part des salarié·es a intérêt au maintien de l’exploitation qui finance leurs vacances au Club Med, ses conclusions tendent à s’économiser une analyse précise des mouvements et de leur composition, au profit de conclusions mécanistes. Comme évoqué précédemment, l’interclassisme n’est pas un poison ou un risque à contenir mais bien la réalité des luttes contemporaines. Car si les luttes de classes n’ont jamais été pures, la décomposition du prolétariat aggrave cette tendance.
A la suite du débat ouvert par Astarian et Ferro, les camarades québécois de Temps Libre ont répondu par le numéro 2 de leur revue8, dans un long développement sur la définition des classes. Pour elleux, le prolétariat se définit par le fait de réaliser un travail productif, c’est-à-dire qui produit de la plus-value. Ainsi, on ne part plus d’un rapport de propriété (la possession ou non des moyens de production) mais du cœur du MPC : le rapport social d’exploitation qui lie le capital au prolétariat. Cette définition a pour intérêt d’être précise, permettant de distinguer à tout moment qui fait partie – ou non – du prolétariat. Concrètement, l’ouvrier qui participe à la fabrication de la voiture est un prolétaire, mais le contremaître employé par le patron pour le surveiller ne l’est pas. Le livreur Deliveroo est un prolétaire en ce qu’il participe à la production de la marchandise qui est ici le repas livré, mais la caissière du supermarché ne réalise pas de travail productif, son rôle étant de transformer la marchandise en argent pour le capital, et donc se situe dans la sphère de circulation et non pas dans la sphère productive. À cela, Temps Libre ajoute que lorsque un·e travailleur·euse remplit une tâche de domination déléguée par le capital, alors iel s’exclut du prolétariat, même si le reste de son travail est productif.

La classe moyenne est quant à elle définie négativement : elle n’a pas d’essence propre et donc pas de rôle prédéterminé dans la lutte des classes du fait de son hétérogénéité. Pour y voir plus clair, Temps Libre dresse une série de 5 fonctions qu’occupent différents groupes appartenant à la classe moyenne :
- La première recoupe les tâches répressives. On y range toutes les professions ayant pour but de museler, contenir et écraser les luttes soit, assez logiquement, les militaires, les flics, et tous les types de RG.
- On trouve ensuite le travail de direction et de surveillance effectuée sur les lieux de travail effectué par les manager·euses, mais aussi par les ingénieur·es dont le but est d’optimiser les process – maximiser l’exploitation.
- Il y a également au sein de la classe moyenne le travail de production et de reproduction idéologique de la société dans son ensemble (au-delà de la sphère de la production proprement dite). Dans ce cortège défilent les essayistes, éditorialistes, journalistes et tout autres curés ou enseignant·es-chercheur·ses. Si ces dernier·es peuvent disposer d’une certaine marge de manœuvre, celle-ci est déterminée par l’état de la lutte des classes, et leur production radicale s’arrête ainsi aujourd’hui à l’incessante redécouverte des communs.
- On retrouve par la suite l’ensemble des activités ayant pour but l’accélération des cycles de rotation du capital par la fluidification des échanges et la facilitation de l’écoulement des marchandises. Dit autrement, ce sont toutes les tâches qui permettent de passer de la forme capital-marchandise à la forme argent, et de cette dernière à la forme capital productif : les métiers de la publicité, du marketing et de la vente.
- Enfin, le travail de reproduction directe de la force de travail. Cette fraction, essentiellement féminine, reprend tous les métiers permettant de former, soigner et rendre disponible (garde des enfants) la force de travail. Ici figurent les infirmièr⋅es, professeur⋅es jusqu’au secondaire9, etc. Alors que les autres fonctions sont des fonctions déléguées par le capital, celle-ci se distingue car ses membres ont été historiquement exclus de la production de plus-value.
Ces fonctions ne sont ni exhaustives ni étanches, Tibo in Shape est autant un agent de la reproduction idéologique de la société lorsqu’il tourne des vlogs avec Gabriel Attal qu’il ne participe à l’accélération des cycles de rotation du capital dans son rôle d’homme-sandwich des temps modernes.
Toutefois, cette définition se heurte très vite à la complexité du vécu des travailleur·se·s. Pour une même tâche – selon qu’elle s’insère dans un rapport productif ou non – le·a même individu·e peut être prolétaire ou non. Par exemple, l’ouvrier qui bosse dans une usine d’obus nationale sera prolétaire si l’arme est vendue à un pays tiers, ou non si elle est utilisée directement par l’Etat en question. Autre difficulté : une personne peut être prolétaire un jour et ne plus l’être le lendemain, selon qu’elle travaille en intérim, ou pour peu que la destination de la marchandise qu’elle produit ne change. Enfin, le problème majeur est que dans cette définition une part importante des sans-réserves est exclue du prolétariat, que ce soit les chômeur·ses, les précaires, les travailleur·ses dont le travail dépend de la circulation, etc. Temps Libre tente de s‘en sortir en montrant qu’historiquement, les femmes ont été globalement exclues des emplois productifs, et assignées aux tâches de reproduction. En effet, les travaux des féministes marxistes10 ont montré comment, lors du passage du féodalisme au capitalisme, les femmes ont été exclues par toute une série de mesures des usines et plus généralement de la sphère publique. Cette exclusion a eu pour résultat leur cantonnement à la sphère privée où elles étaient assignées à l’ensemble du travail reproductif, c’est-à-dire tout ce qui permettait aux ouvriers de se présenter en forme le lendemain à l’usine pour retourner travailler, et d’être remplacés lorsque leur corps arrive à échéance par une nouvelle génération de travailleurs tout beaux tout neufs. Si Temps Libre reconnaît à juste titre que les luttes féministes sont particulièrement subversives, car elles s’attaquent – en déstabilisant les rôles de genre – à un point essentiel du mode de production (la reproduction de la force de travail), alors pourquoi les séparer du prolétariat ? En quoi le capital serait plus menacé par une attaque sur la production que la reproduction des conditions de possibilité de cette production ?
Parce que le cœur du problème réside ici : le prolétariat est la seule classe à même de renverser le capitalisme. Élaborer une définition aussi restrictive tend à exclure de nombreux groupes qui ne semblent pourtant pas moins enclins à abolir ce dernier. Plus globalement, on peine à voir comment cette division stricte et individuelle possède une quelconque utilité pour analyser des mouvements : lors d’une insurrection, le fait que, quand deux travailleur·ses crament leur usine d’automobiles, l’un·e s’occupait du nettoyage quand l’autre était dans la fabrication du moteur ne change pas profondément leur rapport au capital ni leur activité dans le processus révolutionnaire.
Qu’est-ce qui fait du prolétariat une classe révolutionnaire ?
S’il importe à ce point de définir rigoureusement les classes sociales, ce n’est pas par souci de coller au plus près au vieux sujet révolutionnaire marxiste qui trône au panthéon de la mythologie révolutionnaire. Il n’est pas question de prétendre que ce qui est prolétarien est bon, irait forcément dans le sens de l’histoire et annoncerait l’imminence du Grand Soir, et qu’inversement tout ce qui ne correspond pas aux représentations fantasmagoriques qu’on se fait de la révolution russe (qui soit dit en passant s’est accomplie sans que ledit prolétariat ne soit aux manettes mais c’est un autre sujet) est à jeter aux orties. Pour nous, toute théorie des classes, précisément parce qu’elle est dynamique et ne se satisfait pas d’une typologie d’ordre sociologique11, est une théorie de la révolution. Elle doit rendre compte du lien qui unit le cours quotidien de la lutte des classes (l’exploitation au premier chef) et l’explosion de la contradiction entre capital et travail : la révolution est produite par l’activité spécifique des classes en lutte et non par des projets de société qu’on aurait imaginés ici et maintenant et dont il s’agirait de faire la propagande autour de nous.
On en revient à la même problématique que pour la classe moyenne : comment définir le prolétariat ? La question est plus épineuse qu’il n’y paraît. Dans toute l’œuvre de Marx, on ne trouve aucune définition précise et systématique, tout simplement parce que ce n’était alors pas nécessaire. Nous avons suffisamment insisté là-dessus : auparavant, le prolétariat était donné comme identique à la classe ouvrière. On avait un beau sujet révolutionnaire prêt à l’emploi, regroupé spatialement dans l’usine (ce qui est très pratique pour l’organiser), conscient de ses intérêts et agissant au travers d’organes politiques clairs et net (le parti, les syndicats, les conseils ouvriers, etc.). Pour la faire simple, le prolétariat, c’était celles et ceux (mais surtout ceux) qui se rebellaient contre leur patron.

Désormais, tout n’est plus aussi transparent. On l’a dit, l’identité ouvrière est en lambeaux, on ne peut plus aussi facilement qu’avant admirer le prolétariat qui fait son travail de prolétaire en bleu de travail, posté sur une chaîne de montage. Mais il n’a pas disparu pour autant, il y a toujours de l’exploitation, au sens d’extraction de plus-value, une division du travail, etc. Il faut alors trouver un autre critère pour comprendre quels habits revêt aujourd’hui la société de classes. Certain·es ont retenu celui de “sans réserve” : est prolétaire celui qui ne possède rien d’autre que sa force de travail pour vivre (et est donc contraint·e de se soumettre au salariat). Cette définition, souvent très creuse, devient rapidement un quasi-synonyme de “pauvres” que l’injustice et la misère pousseraient à la révolte. De plus, elle rend mal compte de la diversité du prolétariat en réduisant l’enjeu des “intérêts à faire la révolution” à une question de revenus, comme si le patron d’une start-up endettée pouvait garnir les rangs des “sans-réserves”, contrairement à l’ouvrier-raffineur ou au docker touchant un salaire confortable. La classe moyenne aussi peut être pauvre, et c’est bien ce qui lui permet de s’assimiler au “peuple” !
Alors que faire avec ce concept bien encombrant et dont on ne peut pourtant se passer ? Pour nous, le prolétariat est une abstraction, pas un groupe qu’on pourrait délimiter sociologiquement par son niveau de vie financier, ses pratiques culturelles, etc. Ça, c’est le boulot des sociologues et ce qu’iels désignent comme les “classes populaires”. Nous nous bornerons à deux thèses pour couper court à cette grille de lecture.
- Le prolétariat est un rapport au capital avant d’être une somme d’individu·es. De la même manière, il ne sert à rien de rentrer dans le détail de l’activité de chaque travailleur·euse pour jauger son degré de productivité à un moment T, distinguer ce qui est productif et ce qui ne l’est pas. Partant :
- Le prolétariat est un·e travailleur·euse collectif·ve (il inclut donc les chômeur·ses), une force de travail sociale qui ne se comprend que du point de vue de l’ensemble12. On ne peut donc pas, ou plutôt il est parfaitement inutile, de classifier les prolétaires au singulier à partir de leur situation professionnelle. Et ça complique bien des choses.
En effet, qu’est-ce qui donne forme à cette abstraction ? C’est le concept de contradiction qui nous donne la clef pour rendre intelligible le prolétariat par-delà ses manifestations historiques particulières (qu’il s’agisse du peuple parisien en armes sur les barricades de 1848, des conseils ouvriers en Allemagne et en Italie au sortir de la Seconde Guerre mondiale, jusqu’aux luttes plus contemporaines auxquelles nous assistons et participons, quelle que soit la forme qu’elles prennent). Qu’entend-on par “contradiction” qui diffère si sensiblement de la notion plus vague d’antagonisme, d’opposition (les pauvres contre les riches, les dominant·es contre les dominé·es, etc.) ? Il nous faut ici opérer une petite digression théorique. Pour nous, une contradiction se caractérise par un double mouvement d’exclusion mutuelle et d’implication réciproque. Pour le dire en des termes moins barbares, une contradiction est un conflit conceptuel qu’on ne peut pas esquiver, dont chaque pôle n’existe que par son rapport à l’autre, et cette tension produit son propre dépassement par sa dynamique interne. On sait précisément que la dynamique interne, et fondamentale, du capitalisme, c’est la production d’une plus-value, c’est-à-dire la vente d’une marchandise à une valeur d’échange supérieure à la valeur qu’elle contient (le temps de travail social nécessaire à sa production). C’est grâce à l’écart entre la valeur produite par le travailleur et la rémunération de sa force de travail (le surtravail) qu’on peut créer cette plus-value. Si tout se vendait à son exacte valeur, il n’y aurait pas de survaleur, pas de profit et pas de capitalisme. En restant très schématique, le capitaliste peut maximiser sa plus-value (ce qui lui est absolument nécessaire pour qu’il survive face à la concurrence) de deux façons : la première – la plus évidente – est de faire travailler les prolétaires plus longtemps. Mais, bien malheureusement, le corps des prolétaires a des limites physiques et les journées ne durent que 24 heures. Il faut donc, à terme, recourir au second moyen : améliorer la productivité et réduire les coûts salariaux13. La solution est donc de remplacer les travailleur·ses par des machines, alors même que seul le travail vivant est producteur de plus-value. C’est en cela que le prolétariat est, selon la formule élaborée par Théorie Communiste, “toujours nécessaire et toujours de trop”14 : il habite la contradiction fondamentale du mode de production capitaliste. Il n’y a pas seulement antagonisme, opposition entre le capitaliste et l’ouvrier·e – dans le sens où ils luttent pour la répartition de la valeur produite – mais contradiction puisque cette dynamique, où le capital évince ce par quoi il se reproduit, est structurellement insoluble, paradoxale dans ses propres termes, et ne peut donc pas être résorbée.
Un dernier point : si le prolétariat est bel et bien la classe qui fait la révolution, c’est uniquement parce qu’il est la classe qui se situe au cœur de cette contradiction, c’est-à-dire en vertu de la position contradictoire qu’il occupe au sein des rapports de production. En effet, jamais dans l’histoire des modes de production une classe n’a été à ce point à la fois perpétuellement exclue de la société, et moteur de cette même société. Il y a toujours eu des marginaux·ales dont la seule possibilité d’existence exigeait l’abolition de tout ce qui existe (les mendiant·es de la féodalité par exemple) mais jamais ces damné·es de la terre n’avaient incarné le moteur de l’économie. Pour cette raison, il n’y a pas de nature prolétarienne qui tendrait mécaniquement vers la démocratie ou l’égalité entre les hommes – et encore moins entre les hommes et les femmes –, le prolétariat n’est porteur d’aucune mission historique : il n’est qu’une classe du mode de production capitaliste, et c’est en tant qu’il est cette classe (une classe contradictoire, instable) qu’il peut être amené, ou non, à faire la révolution. C’est le piège de la critique de l’interclassisme : penser qu’il suffirait de construire la révolution du prolétariat15 sur des bases prolétariennes, qu’il puisse affirmer ce qu’il est contre les manœuvres sournoises de la classe moyenne, pour qu’on fasse enfin la révolution. Nous pensons, au contraire, qu’il ne faut pas abandonner le prolétariat, mais que celui-ci est amené à s’abolir, et à embarquer avec lui d’importantes couches de la classe moyenne sitôt le processus révolutionnaire enclenché. La révolution est faite par le prolétariat mais n’est pas prolétarienne au sens où il ne la fait pas en tant que prolétariat. Dans un élan qui le dépasse, le prolétariat se dissout, avec toutes les autres classes, dans ce grand maelstrom qu’est l’éclatement de la contradiction.
Conclusion : quelle(s) perspective(s) à l’interclassisme ?
L’interclassisme ne résulte pas d’une manœuvre perverse des fonctionnaires et affilié·es. C’est le produit d’une séquence historique particulière, les mutations du capitalisme ayant accru la segmentation du prolétariat et l’évanescence (du moins apparente, c’est-à-dire politique) des frontières de classe. Au sein du processus de recomposition de l’Etat et de la classe dominante qui suit la restructuration du mode de production capitaliste, la lutte de classe change de forme. Ses cibles ne peuvent plus être l’usine qui a délocalisé à l’autre bout du globe, on s’attaque alors aux symboles de la circulation et de la distribution marchandes : ce qui représente l’Etat sous toutes ses formes, et parfois les flux, du péage au périph’. Une masse composée de jeunes chômeur·ses, précaires, ou travaillant dans l’économie informelle, côtoient bon gré mal gré des salarié·es, des fonctionnaires et des travailleur·ses indépendant·es, et parfois même des ouvrier·es en déshérence. Cet interclassisme, au-delà d’une stratégie de rassemblement pour pallier l’absence d’organisations ouvrières fortes, reflète également le vécu transversal du prolétariat : il est facile de passer d’une carrière stable à un emploi dans l’économie de l’informel, voire de finir au chômage. De plus, l’État prend toujours davantage en charge l’entretien d’une force de travail collective pour permettre sa disponibilité à se faire exploiter par une start-up qui coulera trois mois plus tard, ou par une boîte d’intérim s’adaptant aux besoins fluctuant en main d’œuvre d’une multinationale. L’organisation atomisée du travail dans de nombreux secteurs et le développement des emplois précaires et du chômage entraîne la faiblesse du syndicalisme, et la lutte se déroule donc en-dehors des lieux de travail, face à ce qui est devenu le principal interlocuteur : l’Etat. On demande alors une revalorisation du SMIC, de meilleurs services publics, et pourquoi pas une hausse – ou du moins pas de baisse – des minimas sociaux. L’interclassisme, c’est le contexte de notre époque présente, le capitalisme post-restructuration et l’évolution des acteurs politiques et économiques qui en découle. L’interclassisme est une limite certes, mais pas une limite dont on peut se débarrasser par la force de nos idées. Il faut composer avec les luttes telles qu’elles sont.

Une fois dit cela, on n’a toujours pas de définition réelle de la classe moyenne. En effet, cette définition reste relationnelle à celle des autres classes : la classe moyenne se définit négativement par ce qui n’est ni le prolétariat ni le capital. Elle est issue de la hiérarchie des revenus, comme l’incarnation conjoncturelle de la dualité des éléments fondamentaux dans la relation salariée et le capitalisme en général : le travail simple et le travail qualifié, la production et la distribution, etc. La légitimité de la classe moyenne – comme carrefour de la société salariale avec ses ascensions et ses dégradations et le constant et rude travail de positionnement et de hiérarchie qu’il exige – est l’activité propre de celle-ci, notamment au sein de la représentation politique. La classe moyenne défend (parfois à couteaux tirés !) sa place dans la hiérarchie capitaliste, et donc plus globalement la reproduction de la société salariale : le compromis fordiste, l’Etat providence, etc.
Mais cela ne nous avance pas non plus beaucoup. En effet, il est impossible de définir précisément la classe moyenne en-dehors des séquences historiques dans lesquelles elle agit. Pour autant, tout ça ne nous laisse pas tout à fait désarmé. Les fonctions de la CMS listées par Temps Libre nous aident à naviguer dans le cours réel de la lutte des classes. On peut donc lister les tâches essentielles que la CMS remplit pour le capital au quotidien pour présumer de son comportement en contexte insurrectionnel, mais il faudra toujours regarder dans les luttes concrètes quelles classes ou quelles fractions de classe agissent de telle ou telle manière. Il ne suffit pas de débusquer l’interclassisme dans les mouvements, il faut voir comment il se configure historiquement. Nulle question d’hégémonie ou de bataille idéologique portées par des agents de la classe moyenne là-dedans, mais encore et toujours la forme historique que prend le rapport fondamental et contradictoire qu’entretiennent le prolétariat et le capital. Mais les luttes ne se définissent pas que par leur interclassisme ou non. Dire que le prolétariat est aujourd’hui segmenté, c’est regarder comment toutes ces segmentations prennent forme dans les luttes, même lorsqu’il y est seul. Toutes les déterminations, de race, de genre, de secteur pro, etc., nous empêchent d’attendre simplement qu’il se manifeste seul dans toute sa pureté.
Nous n’avons donc à notre portée que de maigres clefs de compréhension de la réalité en lieu et place de réponses politiques aptes à devancer le mouvement réel. Il s’agit constamment d’observer les acteur·ices en lutte, la trajectoire qu’emprunte chaque mouvement et comment les classes se définissent à ce moment, de façon toujours relationnelle. Pour autant, cela ne signifie en aucun cas qu’il faut se jeter à corps perdu dans toute effervescence dans l’espoir de pouvoir y orienter le cours des événements. L’analyse de classe est indispensable pour saisir les intérêts en action, et donc les limites de la lutte. On ne peut s’économiser la tâche d’avoir à décrire ce qu’est effectivement la division en classes telle qu’elle se manifeste, c’est-à-dire situer les groupes selon leur sphère d’appartenance : production, reproduction (les profs, les fonctionnaires, plus généralement la fonction spécifique de l’Etat), circulation, encadrement. Ces catégories sont indispensables à la compréhension des luttes, mais cela ne suffit pas dans le cadre d’une lutte interclassiste. Il faut fuir les logiques de classification rigide et mécaniste sans intérêt pour une théorie de la révolution. En définitive, rien n’est figé dans les luttes, car « toutes ces strates et couches sociales qui décrivent aussi les classes moyennes sont amenées à se dissoudre dans la contradiction qui est la dynamique même du capital, parce qu’elle est contradiction entre des classes, dans laquelle une de ces classes entre constamment en contradiction avec sa propre existence de classe : le prolétariat »16.
Cet article se veut être une introduction sur la question des classes et particulièrement de la classe moyenne salariée, il n’a pas pour but d’être exhaustif et nous n’avons pas souhaité rentrer dans des détails qui auraient pu perdre nos lecteur·ices.
Si toutefois iels désirent approfondir ce sujet, nous recommandons les sources suivantes :
- Astarian et Ferro, Le ménage à trois de la lutte des classes. Classe moyenne salariée, prolétariat et capital, Ed. de l’Asymétrie, 2019. Disponible chapitre par chapitre sur le site Hic Salta :
https://www.hicsalta-communisation.com/category/classe-moyenne - Le n°2 de la revue Temps libre, Contributions à la théorie des classes (2021) :
https://pouruntempslibre.org/temps-libre-ii/ - L’émission du podcast Sortir du capitalisme, « Révolution et classes sociales » (18 décembre 2023), autour du n°2 de la revue Temps libre, qui a le mérite de vulgariser en 1H30 l’ensemble du propos du numéro :
https://sortirducapitalisme.fr/emissions/revolution-et-classes-sociales/ - Suite à la parution du livre d’Astarian et Ferrot, la critique en deux parties des thèses du livre par les membres de la revue Temps Libre :
https://pouruntempslibre.org/2021/12/21/766/
https://pouruntempslibre.org/2021/12/27/astarian-ferro-et-critiques-improductives-sur-quelques-objections-lancees-a-temps-libre-n-2-deuxieme-partie/ - Et la réponse d’Astarian sur le site dedié au livre Ménage à trois : https://editionsasymetrie.org/menage-a-trois/travail-productif-question-feminine-et-autres-problemes-facheux-reponse-a-temps-libre/
- Le livre Encadrement capitaliste et reproduction du capital d’Alain Bihr (Praxis, 2005) qui présente une analyse du rôle de la classe d’encadrement capitaliste comme portant le projet politique spécifique du capitalisme d’Etat et la critique de celui-ci : https://classiques.uqam.ca/contemporains/bihr_alain/encadrement_capitaliste/encadrement_capitaliste_texte.html
- Le numéro 27 de la revue Théorie Communiste, et plus particulièrement la dernière partie Les classes en général, le prolétariat en particulier et quelques autres choses.
- Nous y reviendrons plus loin ↩︎
- On peut ici, à la suite de Jason W. Moore, parler de Grands Intrants, permettant l’accumulation du capital. Voir Jason W. Moore, Le Capitalisme dans la toile de la vie : écologie et accumulation du capital, Editions de l’Asymétrie, 2020. ↩︎
- Le plus souvent pour préserver le microcosme associatif que tiennent d’une main de fer les profs ayant fraîchement emménagé à Saint-Ouen. ↩︎
- Cette même incompréhension de l’interclassisme se retrouve dans le récent texte « La Débâcle – Éléments pour une analyse matérialiste du mouvement du 10 septembre ». Les auteur·ices dressent un portrait encore plus réducteur de la classe moyenne en l’associant simplement aux exécutant·es d’une fonction d’encadrement. Elle saboterait les révoltes à l’aide de pratiques de pacification (demandes adressées à l’Etat et assemblées générales) et de l’idéologie démocratiste.
Si leur description de la classe moyenne souffre des mêmes écueils que celles des autres auteurs dont nous parlerons plus tard, les manquements de leurs analyses se diffusent jusque dans leur vision de la lutte des classes et de l’intervention politique à l’intérieur de celle-ci.
Rejetant toute participation aux mouvements de la gauche traditionnels qui seraient gangrénés par le citoyennisme par opposition aux mouvements des “prolétaires déqualifiés” exempts de tout soupçon, ses auteur·ices ont pourtant bien du mal à dénoncer le démocratisme quand il est constitutif du discours des Gilets Jaunes. Ignorant l’existence de revendications présentes dès avant la mainmise de la gauche sur le mouvement comme celle du RIC, iels stipulent que la différence entre le discours des GJ et ceux de Nuit Debout est de l’ordre du “contenu de classe” sans approfondir. Il y aurait donc des « bons » et des « mauvais” démocratismes. ↩︎ - Nous avions consacré un article à l’étude de ce phénomène à l’occasion du mouvement contre la réforme des retraites de 2023. ↩︎
- Baudelot, Establet, Malemort, La petite-bourgeoisie en France, Ed. Maspéro, 1974. ↩︎
- Astarian et Ferro, Le ménage à trois de la lutte des classes. Classe moyenne salariée, prolétariat et capital, Ed. de l’Asymétrie, 2019.
Un site dédié recense tous les débats ayant fait suite à la publication de l’ouvrage. ↩︎ - Temps Libre II – Contribution à la théorie des classes, Montréal, 2021 ↩︎
- On peut remettre en question l’appartenance des professeur·es du secondaire à cette fonction, particulièrement dans le contexte français ou les professeur·es – notamment de lycée – participent bien plus aux côtés des professeur·es d’université, à la domination idéologique. ↩︎
- Cf. Silvia Federici, Caliban et la Sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, Entremonde, 2017 et Gerda Lerner, « The Lady and the Mill Girl : Changes in the Status of Women in the Age of Jackson », American Studies, vol. 10, no 1, printemps 1969, pp. 5-15. ↩︎
- Si l’on considère la classe uniquement sous son prisme sociologique, on en arrive à des querelles sur le contenu culturel où la preuve d’appartenance au prolétariat devient le lieu de tout fantasme. Le problème de l’ouvrier qui mange des barbecues ne serait alors pas sa place dans les rapports de production, sa contradiction avec le capital, mais la distinction qu’il subit de la part des bobos du Cours Julien. ↩︎
- Il est d’ailleurs reproduit au niveau de l’ensemble, puisque l’Etat et ses programmes sociaux achètent la force de travail avant qu’elle ne soit employée par un capitaliste individuel. ↩︎
- Soulignons toutefois que le mode d’accumulation basé sur la plus-value absolue semble revenir au premier plan ces derniers temps dans les pays centraux du capitalisme (recul de l’âge de départ à la retraite, travail des adolescents, etc.), mais il n’est pas lieu de traiter ici cette tendance historique encore balbutiante. ↩︎
- « Le capital, en tant que ce qui pose du surtravail, est tout autant et au même moment ce qui pose et ne pose pas de travail nécessaire ; le capital n’est que dans la mesure où le travail est et en même temps n’est pas. » Marx, Grundrisse, Editions Sociales, 2011, p. 361. ↩︎
- Que ce soit, d’ailleurs, le prolétariat ouvriériste ou un ersatz comme les “travailleur·ses déqualifié·es” qu’invoque le texte des camarades du blog Sans Trêve. ↩︎
- AC, “Notes sur les classes moyennes et l’interclassisme”, Carbure, 2016 ↩︎