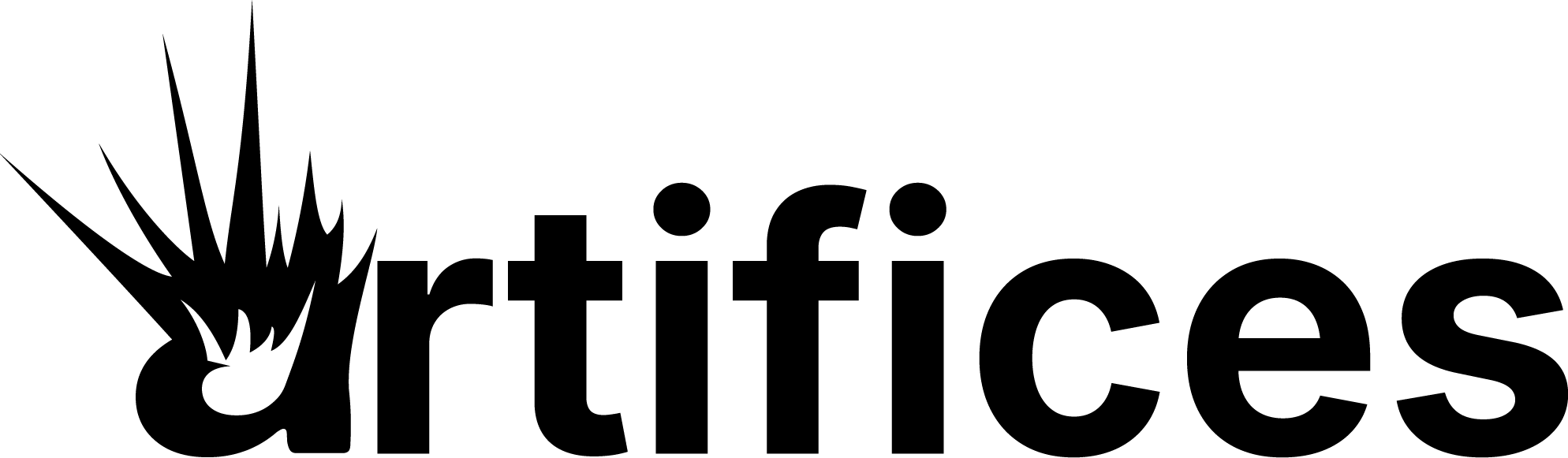La révolution comme anti-politique, le communisme comme abolition du travail
Dans ces deux courts textes, les camarades d’Ediciones Inéditas, basés à Los Angeles, reviennent sur quelques mécompréhensions courantes à propos de ce que signifie, pour nous autres communistes, l’anti-politique et l’anti-travail. Il nous a paru utile de les traduire en français (et de les diffuser sous format brochure) afin de dissiper tout malentendu, alors que les catégories du capital sont encore souvent présupposées comme naturelles et indépassables dans nos luttes.
Pour imprimer, téléchargez le texte en format brochure ici et en format texte là.
L’anti-politique… expliquée ?
Voici notre tentative d’expliquer ce que signifie pour nous l’anti-politique et comment elle est liée à la communisation et, ultimement, au communisme.
Anti-politique : action et théorie qui s’oppose à la sphère de la politique (et donc aussi de l’économie politique). La politique étant la sphère du pouvoir, de l’aliénation, de la médiation et de la domination. Ainsi, l’anti-politique questionne et attaque la médiation et la coercition inhérentes à la démocratie ; la centralité et la domination de l’économie (qu’elle soit capitaliste ou non) dans nos vies, le patriarcat et sa logique mortifère ; le colonialisme et sa persistance ; elle se demande si l’étendue des désirs humains pourrait constituer un programme positif unitaire et s’ouvre à la possibilité d’affinités partagées avec ceux qui ne s’expriment pas politiquement de manière explicite mais attaquent néanmoins ce contre quoi l’anti-politique s’élève (c’est-à-dire les émeutier·es).
L’anti-politique ne cherche pas à « construire un pouvoir » ; bien que la construction de la capacité à élargir l’autodéfense et la reproduction sociale communautaires fasse partie de la lutte contre le pouvoir, il ne s’agit pas de la lutte elle-même. Les ghettos d’immigré·es et les autres peuples dominés ont toujours trouvé des moyens de se soutenir mutuellement face aux attaques directes (fascistes, racistes, la police) ou indirectes (les rapports sociaux racialisés et sexués, l’État et sa politique). C’est ce que nous appelons l’entraide. L’entraide est une force qui nous lie, mais elle n’est pas en soi une force antagoniste. L’État et le capital ne voient pas de problème à ce que les prolétaires se débrouillent seul·es : à bien des égards, ils se déchargent ainsi du fardeau qui pèse sur leurs épaules. L’antipolitique est cette force antagoniste. C’est quand la colère, la douleur ou même la joie descendent dans la rue contre ce monde.
De nombreux moments de l’histoire contemporaine ont montré que la révolte contre le pouvoir n’a pas été initiée par une quelconque coalition punie au préalable (à moins que vous ne rêviez encore de 1917), mais par celleux qui se sont retrouvé·es dans la lutte et ont cherché à étendre et à généraliser leur révolte jusqu’à ce qu’iels soient libres. C’est l’objectif de ce projet. Notre capacité à détruire l’ordre qui maintient le monde tel que nous le vivons actuellement est liée à la rapidité, à l’intensité et à la généralisation de la révolte. Une guerre contre l’ordre qui nous est imposé est une guerre perdue d’avance. C’est ainsi que l’antipolitique est liée à la communisation.
De même, la communisation ne cherche pas à créer de nouveaux nœuds de pouvoir (ou de contre-pouvoir) mais à agir comme un acide rongeant le pouvoir à travers les brèches créées par un (ou plusieurs) moment(s) révolutionnaire(s). La communisation s’y intéresse à partir de la base. Comment, en tant que prolétaires, abolir ce qui fait de nous des prolétaires racialisé·es et sexué·es (auto-abolition) tout en faisant émerger une autre voie : le communisme. L’anti-politique a tendance à regarder vers le haut, depuis le sol, en se concentrant sur la politique, sur le pouvoir. La communisation n’est donc pas un programme politique à mettre en place, mais plutôt la révolution comme création immédiate du communisme.
Maintenant, quelques remarques sur ce que nous entendons par communisme.
Beaucoup pensent à la Russie stalinienne, à Cuba que Fidel Castro a dirigé pendant des décennies, ou même au régime nord-coréen. Tous ces États-nations revendiquent l’intention de construire le communisme par le biais d’une variante du socialisme d’État. En tant qu’anarchistes, qui se disent également communistes, nous considérons toutes leurs tentatives comme différentes formes de capitalisme d’État. L’argent existe toujours. Des marchandises sont toujours produites. Il y a toujours une police et des prisons. La violence sexiste et la division du travail sont largement maintenues. Le travail en tant que sphère de vie séparée du reste de la vie aussi. La race survit et se perpétue violemment. La valeur est toujours valorisée. L’État est toujours le décideur final de ce qui sera et de ce qui ne sera pas.
Le communisme est un mode de vie libre et sans classes. Pas d’État, pas d’argent, pas de production de marchandises, l’abolition du sexe et de la race en tant que catégories d’oppression, la restitution des terres autochtones volées par le colonialisme, l’abolition du travail, la réintégration de l’art dans la vie quotidienne, l’abolition en grande partie (voire totale) de l’économie comme mode de production, la suppression de la prise de décision politique en tant que sphère de vie spécialisée et séparée… et les fêtes y seront des bangers.
Il y aurait encore beaucoup à dire et nous aimerions avoir plus de temps pour le faire : ce projet est dirigé par des prolétaires et le temps libre n’est pas un luxe que nous possédons. Ceci n’est qu’une modeste première tentative d’expliquer pourquoi nous disons les choses que nous faisons, pourquoi nous faisons les choses que nous faisons et pourquoi ce projet existe.
La lucha sigue y sigue.

Le communisme comme abolition du travail
L’une des difficultés de vivre avec le travail, en tant qu’anarchistes, est ce refus tenace de laisser un jour être simplement un mercredi ou un lundi. Nous ressentons le besoin de profiter de chaque jour comme une nouvelle occasion de nous engager dans la Gloire de la Vie, mais le régime racial du Capital nous dit plutôt d’exécuter x, y, z et de continuer à avancer. La récompense (un salaire !) nous arrive tous les mois, mais ce mois… disparaît à jamais. Le temps de travail, en échange d’argent, est l’une des façons les plus misérables de mener sa journée, contrairement à ce qu’affirment les apôtres du management. Notre activité nous est ravie de notre vie quotidienne, qu’il s’agisse de faire la navette entre la banlieue et le centre-ville afin de gagner un salaire suffisant pour revenir le lendemain, ou de travailler à domicile tout en étant étranger·e à la vie même dont on jouit habituellement à la maison (cela ne veut pas dire que le foyer est un endroit neutre en ce qui concerne le travail. Les féministes marxistes ont montré que la sphère domestique est également un domaine crucial dans le monde du travail. Mais, en règle générale, le domicile est le lieu du travail nécessaire pour retourner au travail le lendemain, que ce soit pour le soi-disant « soutien de famille » ou pour les femmes au foyer « sans emploi ». Cependant, dans le cas du travail à domicile, le domicile est intégré à l’organisation pour laquelle on travaille).
Le fait est que l’abolition du travail n’est pas un style de vie à choisir parmi tous les autres que l’on peut trouver sur le marché : on peut être « hippie » ou vivre en squat, mais on ne peut pas être « anti-travail » seul. il ne s’agit pas d’une autre identité basée sur la consommation ou d’une simple performance, c’est une chose sociale. Pourquoi ? Bien que nous vivions souvent le travail comme une corvée individuelle, ceux d’entre nous qui sont contraints de travailler contribuent également à reproduire le monde social du travail. Les prolétaires (ou ceux qui ont été dépossédés au point de devoir travailler pour quelqu’un·e d’autre juste pour s’en sortir) sont obligé·es de travailler dans ce monde sous la contrainte : nous n’avons pas d’autre choix (même le fait de s’engager dans le marché noir ou gris du travail n’est pas une échappatoire. La débrouille est de la débrouille).
Comment s’en extraire ? Nous en avons eu des aperçus lors de ce que certain·es ont appelé la Grande Démission [Great Resignation, NdT], ou le Grand Refus. Durant la pandémie de COVID-19, les prolétaires ont été confronté·es à une contradiction difficile à ignorer : notre travail était à la fois « essentiel » (pour le fonctionnement du monde capitaliste), et pourtant notre bien-être ne l’était pas. Néanmoins, ce à quoi nous avons assisté n’était pas tant un mouvement vers l’abolition absolue du travail, mais plutôt un aspect important de l’abolition du travail : le refus du travail.
En tant qu’anti-travailleur·ses, nous pouvons contribuer à la prolifération des tactiques de refus du travail et d’esquive plus générale du travail, mais ce n’est pas suffisant. Les prolétaires de tous les jours, qui n’ont peut-être jamais entendu parler « d’anti-travail » ou de « refus du travail », font de leur mieux pour en faire le moins possible chaque putain de jour et ils sont probablement beaucoup plus nombreux·se que n’importe lequel d’entre nous, les « anti-travailleur·ses ». Il s’agit simplement d’un phénomène naturel pour les gens prédisposés à une certaine oisiveté. Mais l’oisiveté seule n’est pas l’abolition du travail. Ne rien faire n’est pas l’abolition du travail. Pour comprendre cela, nous devons comprendre la nature de ce qu’est le travail.

Travail(le) !?
Une erreur répandue chez certain·es partisan·es de l’abolition du travail est l’idée que plus rien ne sera fait, par personne, pour personne. Mais c’est déjà ce que font les riches. Ils ne font rien (ou presque, mais jamais assez pour que leur richesse atteigne des niveaux aussi obscènes grâce à un salaire direct) et vivent du travail des autres. L’objectif que poursuit l’abolition du travail poursuit, c’est l’élimination de l’exploitation de certain·es par d’autres et la suppression du travail / de l’activité aliénés.
Concrètement, ça signifie que des bâtiments continueront à être construits, que la nourriture sera toujours récoltée et que vous aurez peut-être encore des tâches difficiles à accomplir au cours de votre journée. Mais ce qui est crucial ici, c’est que votre activité sera directement vécue et fera directement partie de votre vie et de celle des personnes avec lesquelles vous formez une communauté. Vous pouvez semer des graines de chia le long d’un ruisseau pour que vous et le reste de nos ami·es puissions en profiter ; vous pouvez aider à monter une tente pour un festival ; vous pouvez aider à la garde des enfants pour que les aîné·es puissent profiter de leur retraite ; vous pouvez aider vos voisin·es à faire démarrer leur voiture si la batterie ne s’allume plus. Et à mesure que toutes ces activités communautaires s’accumulent, nous développons une culture de l’entraide où notre activité profite à chacun·e et où ce bénéfice est connu de tou·tes mais existe au-delà de la comptabilité de l’ordre capitaliste : pour des relations sociales qui ne soient pas mesurées.
Maintenant viennent les récalcitrant·es qui rétorquent que personne ne fera rien sans être payé : un sentiment qui me rappelle que l’endoctrinement capitaliste a des racines profondes. Oui, dans ce monde, beaucoup d’entre nous ne feront sûrement pas grand-chose sans être payé·es précisément parce que nous sommes dépossédé·es ! Non seulement dépossédé·es des moyens de satisfaire nos besoins élémentaires, mais même du temps nécessaire pour vraiment nous amuser ou nous aider les un·es les autres. Mais lorsque nos besoins et nos désirs seront satisfaits, lorsque nous ne serons pas chroniquement épuisé·es mentalement, physiquement et émotionnellement, lorsque nous ne compterons plus les jours jusqu’à la prochaine paie, vous allez avoir beaucoup de temps libre : ou plutôt, le chronométrage ne sera plus une contrainte mentale quotidienne. Qui a besoin de compter les heures lorsque le rythme effréné du Capital est brisé ? Nous associons presque toutes les activités au monde du travail. Je ne cherche pas à valoriser le « labeur » comme l’ont fait les régimes socialistes d’État du siècle dernier (à bas le marteau et la faucille !), mais à faire en sorte que les activités les plus pénibles soient qualitativement différentes sans la pression d’un patron, d’un loyer, d’un flic ou d’un prof au-dessus de votre tête. La vie continuera, avec toutes ses difficultés, l’abolition du travail n’est pas une baguette magique ouvrant un portail magique vers une pure et simple utopie.
Le communisme et l’abolition du travail
L’abolition du travail est, pour reprendre une formule de Marx, le mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses, ou rien. L’abolition du travail n’est pas un moment, une saison ou un style de vie : elle fait partie du contenu du communisme. Par communisme, j’entends simplement un mode de vie libre, sans classes, où l’on peut obtenir ce dont on a besoin et ce que l’on désire (sans que l’on soit conditionné par le capitalisme) et où l’on peut vivre sa vie comme on l’entend. Les détails de cet arrangement dépendent de ceux qui le vivront, mais de nombreux radicaux ont leurs propres idées (par exemple les anarchistes). La seule façon d’éliminer le travail, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est de vivre en commun.
Pourquoi ?
Parce que le fondement même de notre dépossession n’est pas seulement de nous séparer de notre temps (le temps de travail), de notre activité (le salariat) mais aussi de nous séparer les un·es des autres. C’est aussi un besoin fondamental (faute d’un meilleur terme) qui nous est volé, jour après jour.
Sous le capitalisme, les produits de notre travail (les marchandises telles qu’elles sont connues sous le capitalisme, qu’elles soient matérielles ou sous la forme de services) sont emportés sur le marché au prix le plus élevé et avec les salaires les plus bas possibles. Avec le communisme, les soi-disant produits du travail ne seront plus destinés au marché et, parce que l’abolition du travail implique l’abolition de la coercition, l’État perdra également le rôle de décideur ultime qu’endossait l’État socialiste du XXe siècle. En réalité, le métabolisme de notre activité communiste (ou anarchiste) post-capitaliste n’est plus constitué de produits, de marchandises ou de services : il s’agit simplement de choses et d’activités que nous créons pour nous faciliter la vie et pour ceux avec qui nous vivons.
La marche à suivre vers un monde débarrassé du travail ne passe pas par un programme ou une liste d’instructions dictée par l’État : elle passe par nous et notre autonomie.