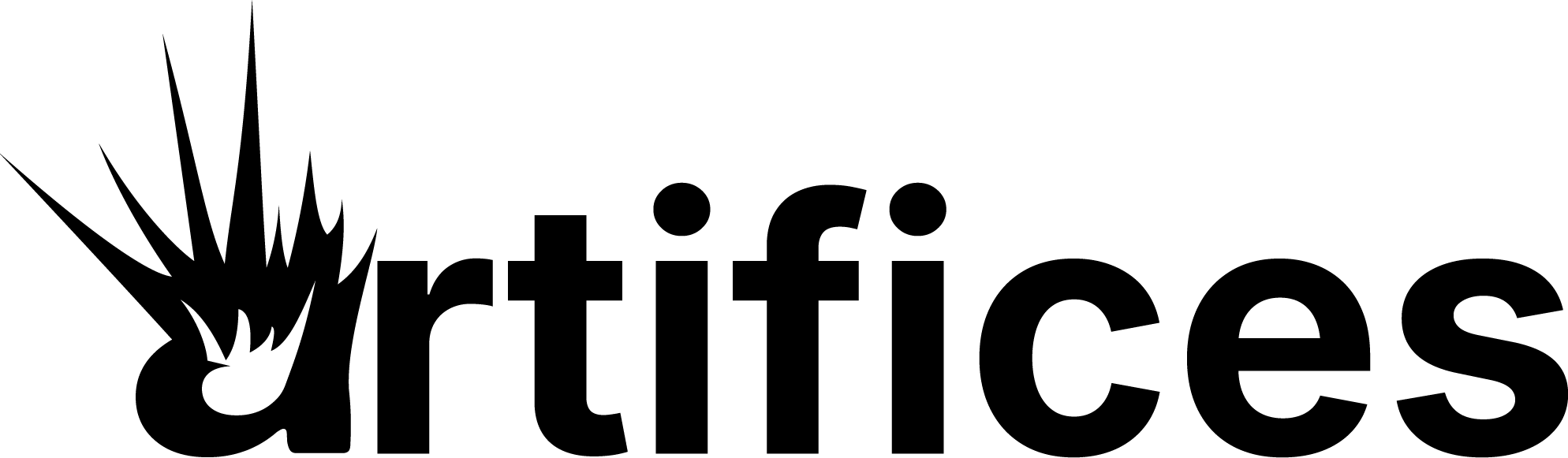La guerre capitaliste – matériaux pour un débat
Nous publions la traduction de ces deux textes sortis autour de la publication de « La guerra capitalista » qui nous donnent des pistes de réflexions adéquates et débarrassées de toute idéologie démocratiste pour appréhender la géopolitique contemporaine et ses nécessaires déterminations capitalistes. Ce choix éditorial se justifie ainsi par l’atonie des discussions autour des enjeux économiques sous-jacents aux conflits géopolitiques mondiaux, et en premier lieu à celui qui surdétermine désormais tous les autres, entre la Chine et les États-Unis. A ce titre, nous souhaitons également signaler la parution du livre de Benjamin Bürbaumer “Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation”, dont il sera question lors d’une présentation organisée le jeudi 5 septembre 2024 à 19h à la librairie Michèle Firk à Montreuil.
Pour imprimer, téléchargez le texte en format brochure ici et en format texte là.
« Nous l’avons fait avec la conviction que l’analyse géopolitique sans la critique de l’économie politique risque de rester un récit trop dépendant des affects individuels. »
Les deux textes que nous publions ci-dessous, compilés par Angry Workers, sont issus d’un débat ayant lieu en Italie autour du livre “La guerre capitaliste. Compétition, centralisation et nouveaux conflits impérialistes” (Mimesis 2022, non traduit, disponible en traduction deepl ici), co-écrit par Emiliano Brancaccio, Stefano Lucarelli et Raffaele Giammetti. Le premier est un entretien avec Lucarelli et le second est une recension de la part de Raffaele Sciortino.
Nous estimons que ces textes et les auteurs qui y sont associés, qui mettent au centre de leurs analyses les enjeux de la critique de l’économie politique, permettent de réengager une discussion sur la guerre, les tensions inter-impérialistes et la manière contemporaine de comprendre la géopolitique. A ce propos, le livre de Bürbaumer “Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation” (La Découverte 2024), riche d’un appareil empirique impressionnant, dont il est possible d’avoir un aperçu ici, nous paraît important tant il vient combler un déficit de discussions et de réflexions sur ces enjeux en France, mais il n’est pas sans poser problème pour autant. L’auteur, se concentrant de moins en moins au fil des pages sur les crises de surproduction pour privilégier une conception de l’impérialisme comme projet politique hégémonique à la Gramsci (opposant notamment deux blocs constitués que serait le capital national américain et le capital transnational américain), flirte avec les risques inhérents à une telle approche, à savoir de surestimer la politique jusqu’à en faire le primat du cours conflictuel des événements, sous-évaluant ainsi les déterminations économiques premières de ces tensions mondiales. Les textes que nous publions ci-dessous cherchent ainsi à offrir une autre prise sur la confrontation de ces impérialismes, d’un côté en étudiant la loi de centralisation du capital et ainsi la confrontation entre blocs créditeurs et débiteurs (bien que la mise en équivalence entre l’intérêt des capitaux nationaux et l’intérêt de leurs États puisse poser question), et de l’autre en retraçant l’histoire de cette restructuration géopolitique, qui trouve son origine dans les crises de surproduction.
Le livre dont il est ainsi question est une étude empirique des relations entre les tendances à la centralisation mondiale du capital, la crise et la guerre. La thèse principale est qu’à l’aube d’une crise mondiale, la tendance à la centralisation du capital, qui se déroule « pacifiquement » en temps normal par le biais de fusions-acquisitions, se heurte au cadre de l’État-nation. Plus précisément, le conflit principal apparaît entre le principal bloc endetté (les États-Unis) et le principal bloc créditeur (la Chine) et leurs alliés respectifs. Dans la situation actuelle, les États-Unis ont imposé unilatéralement un néo-protectionnisme afin d’empêcher la Chine de continuer à acquérir des actifs productifs et des ressources. En ce moment, les banques centrales héritent d’un nouveau rôle politique dans la « guerre des monnaies » mondiale, en essayant de garantir ou de remettre en question la position hégémonique du dollar américain, qui a permis aux États-Unis d’accumuler un montant de dette colossal sans être « punis par les marchés ». À mesure que les tensions entre créanciers et débiteurs s’intensifient, les « sanctions » et les escalades militaires deviennent inévitables, comme en témoigne l’augmentation significative des dépenses militaires.
Les deux textes ci-dessous traitent de ces questions d’une manière plutôt académique et parfois peut-être trop rhétorique. Nous pensons néanmoins qu’ils sont fructueux, car ils remettent en question les points de vue campistes qui veulent réduire le débat sur la guerre à la question des « bonnes ou mauvaises nations » ou qui dépeignent la guerre en Ukraine comme un conflit portant sur la « démocratie ».
Pour l’internationalisme prolétarien [et le défaitisme révolutionnaire]

Une discussion sur la centralisation du capital, les nouveaux impérialismes et la guerre. Entretien de Francesco Pezzulli avec Stefano Lucarelli.
Dans le livre que vous avez récemment publié en collaboration avec Emiliano Brancaccio et Raffaele Giammetti, vous écrivez que « la guerre capitaliste est la continuation de la lutte des classes avec des moyens nouveaux et plus diaboliques ». Pouvez-vous expliquer comment vous êtes arrivés à cette conclusion ?
Nous sommes partis d’un fait, la soi-disant « loi » de la centralisation du capital entre des mains de moins en moins nombreuses, théorisée à l’origine par Marx, qui peut être vérifiée empiriquement. À bien y réfléchir, il s’agit d’une question qui a toujours été ignorée par les économistes contemporains de Marx, mais qui est en fait beaucoup plus pertinente aujourd’hui que, par exemple, les réflexions sur la baisse tendancielle du taux de profit. L’analyse de la centralisation du capital est restée à l’arrière-plan, même dans les analyses critiques du processus de mondialisation qui se sont répandues surtout dans la seconde moitié des années 1990. En tout état de cause, elle n’avait jamais été analysée avec les outils adéquats. Aujourd’hui, comme nous le démontrons dans le livre, ce processus est confirmé par des données empiriques.
Il est curieux qu’après la crise mondiale de 2007-2008, l’accent sur cette « loi » tendancielle et systémique ait été mis précisément par les analystes du monde financier dans les colonnes du Financial Times ou de The Economist. Les magnats de la haute finance eux-mêmes ont commencé à débattre du processus de centralisation, eux qui – pour reprendre les termes de Warren Buffett – s’estiment être les gagnants de la guerre de classes.
En étudiant le processus de centralisation de la manière la plus précise possible – en utilisant des techniques statistiques et économétriques appropriées à partir des données disponibles pour comprendre la hiérarchie des structures de propriété1 qui caractérisent le capitalisme contemporain – nous pouvons mettre en lumière certains aspects de la lutte entre les capitaux. En ce sens, nos études sont inédites dans le champ des sciences sociales. Il a été très important pour nous d’accepter la méthode scientifique que des physiciens comme Giorgio Parisi ont proposée pour étudier l’interaction entre le désordre et les fluctuations dans les systèmes : grâce aux « réseaux » que nous avons pu identifier en appliquant les techniques utilisées dans l’analyse des systèmes complexes, nous pouvons voir qu’aujourd’hui plus de 80% du capital mondial est contrôlé par moins de 2% des actionnaires du monde. Ce club restreint de très gros actionnaires rétrécit au fil du temps. Le phénomène touche, à des degrés divers, tous les pays du monde, à commencer par les États-Unis et la Chine.
L’affrontement des capitaux n’est jamais strictement limité au monde financier ou à l’affrontement entre les propriétaires des moyens de production. Les processus qui conduisent à la désintégration de la classe ouvrière dépendent également de cet affrontement entre les capitaux. Plus précisément, lorsque les capitaux créanciers et débiteurs s’identifient aux capitaux de différentes nations, leur lutte économique féroce, dans des circonstances particulières que nous analysons dans le livre, peut se transformer en une véritable guerre militaire. Le travail, bien sûr, souffre de plus en plus des effets dévastateurs de la lutte intercapitaliste.
Lorsque la guerre devient une issue possible de l’affrontement entre capitaux nationaux, le processus de désintégration de la classe sociale subalterne devient encore plus aigu, jusqu’à son point d’explosion : les subalternes ne se reconnaissent plus comme une classe sociale, mais comme un groupe dont les intérêts ne sont compréhensibles que dans une perspective nationaliste. En ce sens, on peut dire que la guerre capitaliste est la continuation de la lutte des classes par des moyens nouveaux et plus infernaux.
L’un des mérites du livre est de nous rappeler que la lutte des classes ne se déroule pas exclusivement entre les deux classes « fondamentales », mais également au sein de la classe capitaliste elle-même. Pouvez-vous nous rappeler quels ont été les moments les plus récents et les plus significatifs de la lutte au sein de la classe capitaliste du point de vue de l’histoire économique ?
La centralisation du capital dans un nombre de plus en plus restreint de mains est le résultat d’une lutte interne au sein de la classe capitaliste, entre le capital débiteur en difficulté et le capital créancier qui tente de l’absorber et de « l’avaler ». D’une certaine manière, l’analyse des affrontements entre capitaux est plus importante que l’analyse des conflits de classes. Dans tout système économique, il y a des grands capitaux et des petits capitaux. Ce qui nous a particulièrement frappés, c’est que dans cette grande mer où les gros poissons se nourrissent des petits poissons – pour reprendre l’image de la célèbre gravure de Bruegel l’Ancien – il y a en même temps une réorganisation des gros poissons autour de différents pôles, pôles qui sont distincts les uns des autres en raison d’une caractéristique fondamentale dans une économie monétaire de production2 : on peut devenir un gros poisson soit en accumulant des dettes, soit de manière spéculative en accumulant des crédits. Les créanciers et les débiteurs peuvent coexister pacifiquement, mais cela ne peut se faire que de façon intéressée. Lorsque les créanciers utilisent les crédits accumulés d’une manière qui n’arrange pas les grands débiteurs, la paix est compromise. C’est le cas, par exemple, lorsque les crédits sont utilisés pour redéfinir les structures de propriété qui étaient traditionnellement sous contrôle des débiteurs. Les grands créanciers et les grands débiteurs se sont préparés à la guerre en accumulant des armes. C’est ce que démontre une analyse des dépenses militaires au cours des vingt dernières années.
Depuis au moins le début des années 2000, nous réfléchissons au passage « de l’impérialisme à l’empire » comme caractéristique de la mondialisation capitaliste. Dans votre livre, la catégorie d’impérialisme est centrale alors que celle de l’empire est rapidement considérée comme « nébuleuse » (voir p.196). Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous considérez l’impérialisme comme une catégorie centrale et l’empire comme une entité prétendument « nébuleuse » ?
La catégorie d’ »empire » est une notion dépassée. Mais cela ne signifie pas qu’il faille remettre en avant le concept d’ »impérialisme » dans les termes ossifiés du vingtième siècle. Ni qu’il faille nier que l’ouvrage « Empire » de Hardt et Negri était un texte important et stimulant. Et vous avez raison de reconnaître l’importance formative de la réflexion sur la transition de l’impérialisme à l’empire, à laquelle beaucoup d’entre nous ont participé. Cet exercice théorique a débouché sur une manière de faire de la politique qui s’attaque de front aux symboles de la mondialisation, symboles et organisations auxquels nous avons attribué des capacités de commandement direct sur nos vies. C’est une stratégie politique qui n’existe plus aujourd’hui, mais sur laquelle il serait nécessaire de revenir, à partir d’une lecture aussi juste que possible des rapports de force. C’est aussi pour cela que nous avons commencé le travail sur « La guerre capitaliste« . Mais relisons ensemble quelques passages clés de la troisième partie de « Empire » de Negri sur les limites de l’impérialisme et essayons de voir en quoi ces réflexions peuvent encore être pertinentes pour tenter de construire une alternative aux folies politiques que nous vivons depuis plus de deux décennies :
« L’ouvrage de Lénine sur l’impérialisme se présente essentiellement comme une synthèse des analyses des autres auteurs […]. Toutefois, le texte de Lénine apporte aussi ses contributions originales, dont la plus importante est de poser la critique de l’impérialisme d’un point de vue subjectif, et de la relier ainsi à la notion marxiste du potentiel révolutionnaire des crises […]. Lénine a adopté l’hypothèse de Hilferding selon laquelle le capital est entré dans une nouvelle phase de développement international définie par le monopole et cela a conduit à un accroissement des contradictions […]. Il n’acceptait pas, toutefois, que l’utopie d’une banque internationale unifiée pût être prise au sérieux et qu’une “subsomption” – de la crise pût jamais intervenir. […] Lénine était d’accord avec la thèse de base de Kautsky sur la tendance, dans le développement capitaliste, vers une coopération internationale des différents capitaux financiers nationaux, et peut-être même vers la constitution d’un trust mondial unique. Ce qu’il refusait résolument, en revanche, était le fait que Kautsky utilisait cette vision d’un avenir paisible pour nier la dynamique de la réalité présente. Lénine dénonçait ainsi son « désir profondément réactionnaire de gommer les contradictions » de la situation présente […] [À] travers sa réélaboration politique du concept d’impérialisme et plus que tout autre marxiste, Lénine a été capable d’anticiper le passage à une nouvelle phase du capital au-delà de l’impérialisme, et d’identifier le lieu – c’est-à-dire le non-lieu – d’apparition de la souveraineté impériale. […][L]’impérialisme repose lourdement sur ces frontières fixées et sur la distinction entre intérieur et extérieur. L’impérialisme crée actuellement une camisole de force pour le capital – ou, plus précisément, à un certain point, les frontières créées par les pratiques impériales obstruent le développement capitaliste et la réalisation complète du marché mondial. Le capital devrait finir par triompher de l’impérialisme et détruire les barrières entre intérieur et extérieur. […] Telle est l’alternative implicite dans l’œuvre de Lénine : ou la révolution mondiale communiste, ou l’Empire ».
Il me semble que dans « Empire« , la possibilité qu’il existe différents types d’impérialisme n’est pas niée. L’impérialisme n’est pas réductible à un modèle abstrait unique, sauf pour un besoin de simplification de la part des auteurs. Ce que nous montrons dans « La guerre capitaliste« , c’est la coprésence d’au moins deux modes d’impérialisme, l’un hostile à l’autre. Tous deux ne sont pas réductibles au modèle kautskyen de l’impérialisme du vingtième siècle. Dans le « Lexique post-fordiste » (Feltrinelli, 2001), Hardt identifie une souveraineté impériale 1) dans un dispositif de domination décentralisé et décentralisateur représenté par le marché mondial, 2) dans un ordre qui suspend de facto l’histoire et cherche à fixer pour l’éternité l’état actuel des choses, 3) dans le fait que la distinction entre sphère publique et sphère privée tend à s’estomper, et 4) dans un pouvoir toujours consacré à la paix dans lequel il ne peut y avoir de guerre contre un ennemi extérieur. Malgré ces efforts pour définir les traits invariants d’une souveraineté impériale concrète, nous avons rapidement dû reconnaître que ce que nous appelions « empire » était quelque chose de multilatéral.
En outre, il s’est caractérisé par des crises financières et économiques récurrentes qui se sont accompagnées de tensions internationales. Ces tensions se sont traduites par des guerres qui présupposaient l’identification d’ennemis extérieurs rattachés à des territoires nationaux spécifiques : pensez à l’Afghanistan, à l’Irak, à la Syrie. En 2011, Christian Marazzi a parlé de « coopération conflictuelle » au niveau de la gouvernance multipolaire, reconnaissant que la Réserve fédérale spéculait sur des politiques monétaires restrictives dans les pays émergents :
« Les banques centrales des pays émergents, qui ont mené des politiques monétaires expansionnistes au cours des trois dernières années et ont ainsi contribué à éviter une récession mondiale de longue durée, sont maintenant appelées par la Fed à faire le sale boulot, à savoir augmenter les taux d’intérêt pour réduire le risque d’inflation à l’échelle mondiale ».
C’est précisément son multilatéralisme qui a rendu l’empire ingouvernable (la thèse est reprise dans « Journal de la crise infinie« , Ombre Corte, 2015). Negri lui-même, dans ses « Cinq leçons de méthode sur la multitude et l’empire » (Rubbettino, 2003), reconnaît que le livre avec Hardt, dont les brouillons remontent à 1997, n’a pas abordé certaines questions qui sont devenues fondamentales : d’une part, la très forte insistance américaine sur l’unilatéralisme de l’action impériale ; d’autre part, le perfectionnement des mécanismes de contrôle qui s’étendent vers la guerre et sont parfois inhérents à la guerre – guerre qui constitue aujourd’hui la souveraineté ou la politique souveraine, tout comme la discipline et le contrôle la constituaient hier.
Ainsi, comme vous le voyez, bien que l’ »Empire » ait représenté tentative importante et novatrice de réorganiser les demandes et les revendications des sujets qui avaient été frappés par la violence du capitalisme – un capitalisme qui se présentait d’ailleurs comme la seule alternative pacifique pour réaliser un monde d’échanges internationaux où il n’y aurait ni vaincus ni ennemis – il ne restait en réalité que très peu des éléments distinctifs de l’empire tels que résumés par Hardt dans l’article que j’ai mentionné. Plus de deux décennies se sont écoulées depuis la tentative de Negri et Hardt de reconstituer une « science de la mobilisation politique » à l’échelle internationale qui supposait une forme de souveraineté mondiale sans centre ni frontières.
L’effort analytique que nous abordons dans « La guerre capitaliste » vise précisément à comprendre les mouvements du grand et du petit capital à l’intérieur et à l’extérieur des frontières nationales et les implications que le processus de centralisation a également au niveau de la souveraineté. C’est précisément ce multilatéralisme dont nous héritons comme conséquence de la centralisation capitaliste. Un multilatéralisme problématique et instable qui définit différentes conceptions de l’ordre mondial en conflit les unes avec les autres.
La guerre russo-ukrainienne est prise comme référence dans le livre. Quelles leçons, du point de vue de votre travail, ce terrible événement nous apporte-t-il ? Si vous deviez vous risquer à une prédiction, comment pensez-vous qu’elle se terminera ?
Si l’on ramène la guerre entre la Russie et l’Ukraine aux relations entre grands créanciers et grands débiteurs, qui sont le résultat du processus de centralisation du capital, elle apparaît sous un jour différent des récits les plus répandus, qui risquent de nous plonger dans une fausse conscience : il ne s’agit pas d’une guerre pour l’autodétermination d’une région ou pour la souveraineté d’une nation, ni pour la dénazification d’un territoire ou pour la liberté d’un peuple agressé. Comme nous l’écrivons dans l’introduction de « La guerre capitaliste » :
« Ce conflit sanglant marque le début d’une compétition économique à grande échelle, qui servira à déterminer si les États-Unis et leurs alliés peuvent passer en toute sécurité du libre-échange au protectionnisme et si tous les autres doivent s’adapter passivement – ou si, à partir de maintenant, les règles du jeu économique seront décidées en fonction d’un ordre différent des relations de pouvoir au niveau mondial. »
Les recherches futures permettront de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse suivante : le grand débiteur (les États-Unis) s’efforce de dépasser le multilatéralisme mondial. Pour revenir à un bipolarisme – ou, si vous préférez utiliser la métaphore proposée par Toni Iero, pour passer d’un truel à un duel – les États-Unis doivent briser l’intégration commerciale russo-européenne et sino-européenne, en créant de force un pôle russo-chinois.
Avec ce livre, nous avons voulu mettre à disposition des outils d’analyse et une méthode scientifique de lecture des événements qui puissent être compris de la manière la plus simple possible. Nous l’avons fait avec la conviction que l’analyse géopolitique sans la critique de l’économie politique risque de s’en tenir à un récit trop dépendant des affects individuels. Et nous l’avons fait dans l’espoir de diffuser un antidote contre la fausse conscience qui est l’un des plus grands obstacles à la reprise d’un véritable débat démocratique dans ce pays. Et moi, en particulier, j’écrivais en ayant toujours en tête un vers d’un poème de Friedrich Hölderlin : « Mais là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve ».
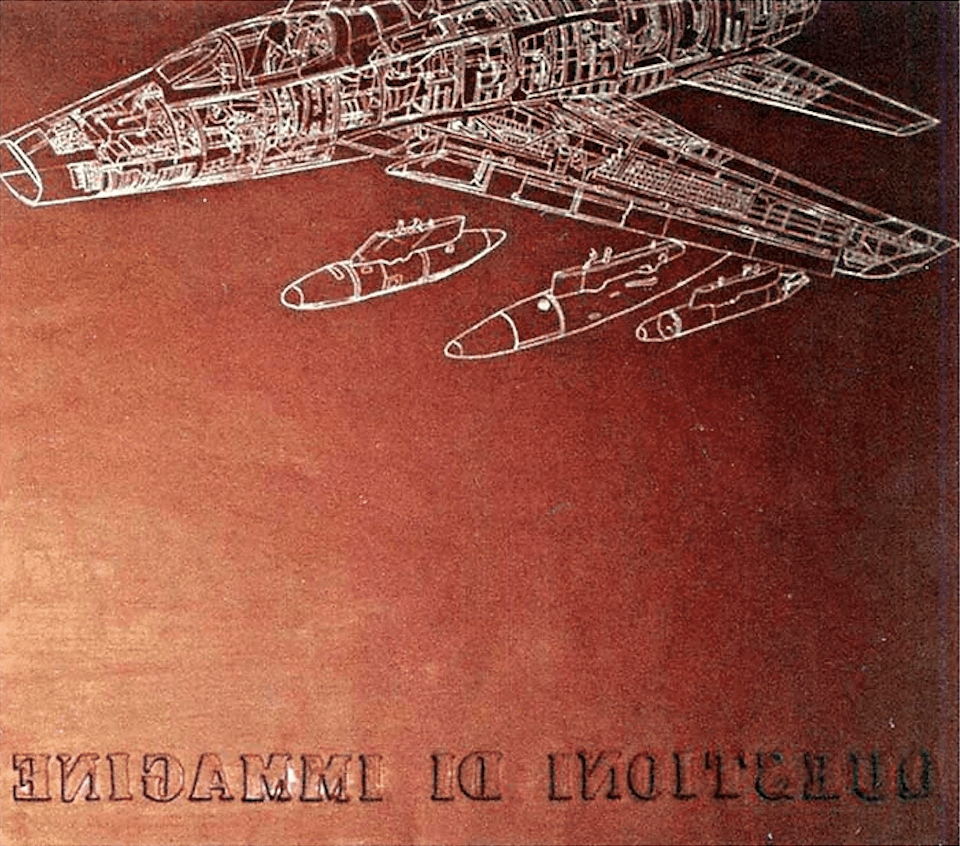
« La guerre capitaliste » – Quelques notes de lecture, par Raffaele Sciortino
Dans le climat politique et culturel actuel, même et peut-être surtout à gauche, avant de parler de la guerre, il semble obligatoire de faire quelques révérences devant les mantras atlantistes de « l’agression russe », de « Poutine, un criminel au service des oligarques », de « la défense de la démocratie ukrainienne », etc. Dans une situation aussi étouffante, un livre comme celui de E. Brancaccio, R. Giammetti, S. Lucarelli (BGL), « La guerre capitaliste« , offre une bouffée d’air frais tout en ramenant les pieds sur terre3. Et ce n’est peut-être pas un hasard si les réflexions qu’il contient sur les racines profondes du conflit actuel ne proviennent pas des cercles de la gauche radicale, aujourd’hui imprégnés d’un néo-progressisme d’importation anglo-saxonne et dépourvus de toute perspective de classe. Il émane au contraire d’universitaires sérieux (oui, des universitaires) qui font preuve d’une capacité de recherche et de raisonnement en groupe, facultés qui ont pratiquement disparu aujourd’hui, et qui n’ont pas peur de nager à contre-courant.
L’analyse de BGL, soutenue par des preuves empiriques et une méthodologie quantitative rigoureuse, place la « loi de tendance » marxiste vers la centralisation du capital dans des oligopoles dont le réseau s’étend à l’échelle mondiale au centre des développements actuels4. Le livre discute des liens entre ce processus de centralisation, d’une part, et la crise de la démocratie (plus précisément : de « l’ordre libéral-démocratique occidental », p. 35) et la tendance à la guerre intercapitaliste, d’autre part5. La lecture est tout sauf neutre, elle devient immédiatement critique de l’état de fait existant : « dans le processus manifeste de centralisation du capital et d’oligarchisation des institutions politiques occidentales, assigner à l’impérialisme des États-Unis et de ses alliés le rôle de rempart des libertés civiles et politiques devient tout simplement grotesque » (p. 13). Et les auteurs le font à partir d’une position clairement antagoniste contre « notre » camp : « lutter contre l’impérialisme de son propre pays » (p. 14).
Ce qui suit est une invitation à lire l’ouvrage accompagnée de certaines de mes observations sur ses points forts et ses lacunes, en vue d’une étude plus approfondie et éventuellement collective. Je fais des remarques brèves et, je l’espère, concises, en demandant d’excuser la nature schématique des formulations à puces.
Tout d’abord, quelques mots sur l’orientation et les implications importantes et précieuses du livre :
– Le livre réintroduit le concept marxiste de centralisation étroitement lié aux actifs productifs des entreprises en question, par opposition à l’utilisation souvent vague et nébuleuse du concept de financiarisation qui a prévalu au cours des dernières décennies en tant que cadre du soi-disant “néolibéralisme”.
– Il souligne le lien sans équivoque entre la centralisation capitaliste et l’impérialisme au sens marxiste « scientifique » du terme — l’impérialisme non pas (seulement) en tant que politique, mais en premier lieu en tant que processus objectif marquant une « phase historique » de l’accumulation capitaliste. Il le fait en revisitant le débat (pas exclusivement) marxiste sur le sujet et une riche bibliographie qui se réfère non seulement aux « classiques » mais aussi aux années 1950-1960-1970 et aux points de référence fondamentaux de l’époque pour le débat sur le « nouvel » impérialisme. Il s’agit d’une invitation à relancer ce débat, fondamental et désormais incontournable pour toute stratégie politique de lutte contre le capitalisme.
– Les auteurs soulignent le lien étroit entre centralisation et guerre – même derrière la guerre en Ukraine – que BGL articule dans le sens d’un affrontement intercapitaliste émergent entre pays créanciers et débiteurs à l’échelle de l’histoire mondiale qui se radicalise (à la Lénine ?) et pousse la concurrence du niveau économique au niveau géopolitique et militaire.
– A un niveau d’analyse inférieur, toujours ancré dans le cadre de la reproduction systémique [du mode de production capitaliste], envisagée ici sous l’angle des conditions de solvabilité des acteurs institutionnels capitalistes, le livre aborde le rôle très important des banques centrales en tant que mécanisme de régulation et donc de lutte intercapitaliste entre débiteurs et créanciers, internes et externes aux différents pays, dans le cadre des processus de centralisation exacerbés par la crise d’accumulation (voir l’ensemble du chapitre 7 de la première partie). Les auteurs reconnaissent ainsi la fonction inévitablement politique des banques centrales, en ne tombant pas dans le piègeévitant des perspectives néoclassiques, qui réduisent le rôle des banques à des pourvoyeurs d’équilibre et d’efficacité des entreprises, mais aussi sans faire de concessions à une quelconque variante de « l’autonomie du politique », caractéristique des lectures subjectivistes (à la manière du « plan du capital ») en vogue dans l’extrême-gauche des années 1970 (pp. 94-95).
Il s’agit d’une question cruciale compte tenu des « guerres de monnaies » sans cesse renouvelées. Je rappelle ici la guerre dollar/euro du début des années 2010, pudiquement rebaptisée crise de la dette souveraine européenne, mais on pourrait aussi remonter à la crise asiatique de 1997-98. Elle est également significative à la lumière du rôle mondial du dollar et des politiques de la Réserve fédérale américaine. Nous devons comprendre le rôle des banques centrales si nous voulons démêler l’imbrication économique actuelle entre l’inflation et les manœuvres à la hausse sur les taux d’intérêt et, plus généralement, comprendre la fin possible de la situation « gelée »6 de la crise latente de la dette et des (faibles) taux de faillite des entreprises en Occident qui ont caractérisé la décennie de « l’assouplissement quantitatif »7.
– Dernier point, mais non des moindres, le livre souligne l’impossibilité du réformisme en tant que réponse graduelle au cours catastrophique du capital.
Voici quelques points problématiques, d’un intérêt fondamental (pour moi) en vue d’une éventuelle étude plus approfondie :
– BGL parle de deux blocs impérialistes (par exemple, p.11), l’un composé des pays débiteurs dirigés par les États-Unis, avec l’Europe dans leur sillage, l’autre émergeant des pays créditeurs dirigés par la Chine, qui sont en pleine ascension, mais dont le développement est instable du fait de l’escalade de la confrontation avec l’hégémonie américaine. Si je comprends bien, nous serions alors en présence non seulement d’un bloc dirigé par la Chine déjà formé, mais aussi d’un défi hégémonique – les auteurs semblent un peu prudents sur ce point – de Pékin à Washington. Le fait est qu’autour de la Chine, on ne voit pas (encore ?) de véritable bloc géopolitique constitué d’alliances (le réalignement sino-russe n’est pas non plus bien établi), même s’il est vrai que Pékin, grâce à son essor économique, joue de plus en plus le rôle de colonne vertébrale pour tout un ensemble de pays, en- dehors du cercle occidental, visiblement insatisfaits d’une hégémonie américaine de plus en plus prédatrice, avec de moins en moins de retours gagnant-gagnant. Cela n’est pas seulement dû à la crainte très justifiée d’une réaction de colère attendue de la part de l’État américain, compte tenu de sa primauté inégalée en matière de soft et hard power. Mais, fondamentalement, cela est lié au rôle central que jouent encore les États-Unis et le dollar dans le circuit international des capitaux, sans qu’aucun remplacement possible ne soit en vue à court ou à moyen terme. À l’heure actuelle, le seul système efficace d’alliances – en réalité, de hiérarchies vassales-tribales – est encore actuellement celui des États-Unis (au-delà de diverses fissures qui, espérons-le, iront en s’accentuant).
– Cela met en évidence une question essentielle : l’asymétrie persistante entre les États-Unis (et le monde occidental) d’une part, et la Chine et d’autres pays émergents d’autre part. Une asymétrie monétaire et financière – amplement documentée, il suffit de penser aux réserves en dollars et en bons du Trésor américains que les pays en excédent commercial sont contraints de détenir, accordant ainsi des prêts à un coût minime et, selon toute probabilité, non remboursables, émis dans la monnaie flottante du débiteur – qui renvoie également, en fin de compte, à la division internationale du travail. Certes, Pékin tente de centraliser son capital (on voit ici le rôle indispensable du parti-État, que les « libéralisateurs » de tout poil voudraient voir saper, ce qui n’est pas surprenant) mais, précisément, il est encore à mi-chemin de ce processus et les obstacles sont aussi grands que la volonté de les surmonter8. Autrement dit, le système mondial est celui de l’impérialisme (en tant que « stade de développement »), mais tous les pays ne sont pas (déjà) impérialistes, même si certains d’entre eux tentent, sur la base de leur propre développement capitaliste interne et de la dynamique des conflits de classe, de s’élever dans la hiérarchie capitaliste mondiale, principalement au sein des chaînes de valeur dans lesquelles le marché mondial les a enchevêtrés. Toutes les centralisations ne sont pas qualitativement égales et, a fortiori, ne garantissent pas l’accès au club des dominants.
– Ce qui précède se rapporte au schéma pays créancier et pays débiteur. Restons-en à la Chine et laissons de côté la position difficile de l’Allemagne et du Japon dans ce schéma. La véritable nouveauté de l’impérialisme post-1970 — nous pourrions dire, à partir du découplage dollar-or de 1971, mais déjà déclenché par l’avènement de l’entreprise multinationale — est une nouvelle modalité et configuration qui sont progressivement devenus structurelles. Sur la base de cette nouvelle configuration impérialiste, en deux mots, les États-Unis dominent les carrefours essentiels du réseau complexe d’exportation et d’importation de capitaux, non pas en dépit de leur déficit de la balance des paiements, mais grâce à lui. Dans le cas des États-Unis, l’endettement dû au double déficit — de la balance des paiements et de l’État — n’est donc finalement pas une preuve de faiblesse mais une force. Nous pouvons considérer comme un atout le fait que les États-Unis et l’hégémonie du dollar puissent forcer tous les acteurs du marché mondial à financer cette dette comme condition d’accès aux circuits de capitaux internationaux et à la liquidité. D’où le rôle incontesté, à ce jour, du dollar à l’international, qui n’est ni équilibré ni équilibrable à court ou moyen terme si la reproduction capitaliste mondiale doit être préservée. Aujourd’hui, un tel atout, structurel et donc stratégique pour Washington, s’avère de plus en plus problématique, car il est de plus en plus prédateur, et déclenche des réactions comme celle de la Chine. Cela n’implique cependant pas, à mon avis, une théorie « décliniste » des États-Unis, mais plutôt le grippage, par secousses, du mécanisme fondamental de la mondialisation asymétrique (et là, il s’agirait de penser à la crise de l’accumulation mondiale, et pas seulement à la montée en puissance chinoise, facteur évidemment important). . La montée de la Chine n’est donc pas un défi hégémonique, mais un défi de survie (analogue, mais à un niveau plus général, à l’action militaire de la Russie en Ukraine). La stratégie américaine de découplage sélectif n’est pas une stratégie de démondialisation et de repli sur une zone géographique circonscrite. On pourrait considérer comme une hypothèse réaliste qu’un tel découplage conviendrait aux adversaires de Washington, à condition que des circuits monétaires alternatifs, mais non antagonistes, soient formés et que l’UE puisse y participer sans être perturbée par les États-Unis. Au lieu de cela, le découplage actuel est l’expression d’une réaffirmation de l’hégémonie mondiale dans de nouvelles conditions (un résultat que je considère toutefois comme problématique, pour des raisons qu’il serait trop long de développer ici).
– Sur le rapport entre centralisation et accumulation : peut-être peut-on avancer l’hypothèse que les deux processus, que l’ouvrage de BGL différencie à juste titre, se déroulent en synergie lorsque l’accumulation fonctionne, mais qu’avec le blocage du processus d’accumulation, la centralisation finit par l’emporter et se substituer, pour ainsi dire, à l’accumulation ? Cela confirme le lien entre la centralisation et la crise capitaliste et, par conséquent, la guerre intercapitaliste. Si tel est le cas, il apparaît plus clairement que ne le pensent les auteurs que c’est à l’enchevêtrement, et non au désenchevêtrement, des lois générales de la tendance du capital que nous sommes confronté·es.
– Enfin, la relation entre centralisation et démocratie : une question épineuse, à commencer par la définition même de ce que l’on entend par démocratie. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas certain que la « carte démocratique » — bien qu’il s’agisse d’un exercice de plus en plus formel, visant à dissimuler l’oligarchisation substantielle de la sphère politique — ait cessé ou cessera d’être jouée par l’Occident, à la fois sur le plan interne, et comme un appel aux classes moyennes et à la jeunesse non occidentale (comme cela s’est produit en Ukraine en 2014), en tant que marque de sa propre supériorité. C’est l’héritage de plus d’un siècle d’impérialisme, et il ne sera pas facile à surmonter.
Il nous reste à comprendre – nous qui ne sommes pas des observateur·ices neutres, bien qu’aujourd’hui contraint·es d’observer plutôt que de contribuer à l’action collective – l’incontournable question du rapport à la lutte des classes, toujours vivace même si rendue invisible ou opaque à ses agents mêmes, et de son cheminement possible vers une lutte accompagnée d’une conscience de classe, celle-ci pas toujours donnée, voire aujourd’hui apparemment lointaine. Quoi qu’il en soit, les questions objectives identifiées par « La guerre capitaliste » nous accompagneront pendant un certain temps.
Raffaele Sciortino, docteur en études politiques et en relations internationales, est chercheur indépendant. Il travaille sur l’économie politique internationale, avec une référence particulière à la mondialisation, et sur la géopolitique dans son entrelacement avec les mouvements sociaux. Il a publié, entre autres, “I dieci anni che sconvolsero il mondo” (Asterios, 2019) et “Stati Uniti e Cina alla scontro globale” (Asterios, 2022).
- C’est-à dire la façon dont une société ou une entreprise est organisée par rapport à ses actionnaires [NDT]. ↩︎
- Expression keynésienne pour souligner le rôle de la monnaie comme condition de la production et ainsi l’influence des mouvements monétaires sur la sphère productive [NDT]. ↩︎
- Un regard critique sur le lien entre la guerre et l’impérialisme émerge progressivement d’un ensemble de travaux, dont celui de Maurizio Lazzarato, « Guerre ou révolution » (2022, non traduit). ↩︎
- Par ailleurs, ce processus de centralisation doit être distingué du processus “normal” de concentration. ↩︎
- Je renvoie ici à la recension d’Andrea Fumagalli pour plus de détails : (http://effimera.org/centralizzazione-della-proprieta-e-capitalismo-contemporaneo-a-proposito-di-la-guerra-capitalista-di-andrea-fumagalli/ ↩︎
- Voir B. Astarian, R. Ferro, Accouchement difficile, épisode 3 : https://www.hicsalta-communisation.com/accueil/accouchement-difficile-episode-3-peut-on-mettre-une-crise-au-congelateur ↩︎
- L’assouplissement quantitatif représente la politique des banques centrales visant à baisser et maintenir bas les taux d’intérêts à travers des achats de titres financiers sur les marchés, afin de permettre aux acteurs d’emprunter à moindre frais, et ainsi de maintenir à flot les stocks de liquidité mondiale et donc d’éviter un grippage de l’économie [NDT]. ↩︎
- Je fais ici référence, et je m’en excuse, à la troisième partie de mon livre « Stati Uniti e Cina allo scontro globale« , récemment publié chez Asterios. [Une version anglaise existe désormais chez Brill, “The US–China Rift and Its Impact on Globalisation” (2024), en pdf ici.] ↩︎